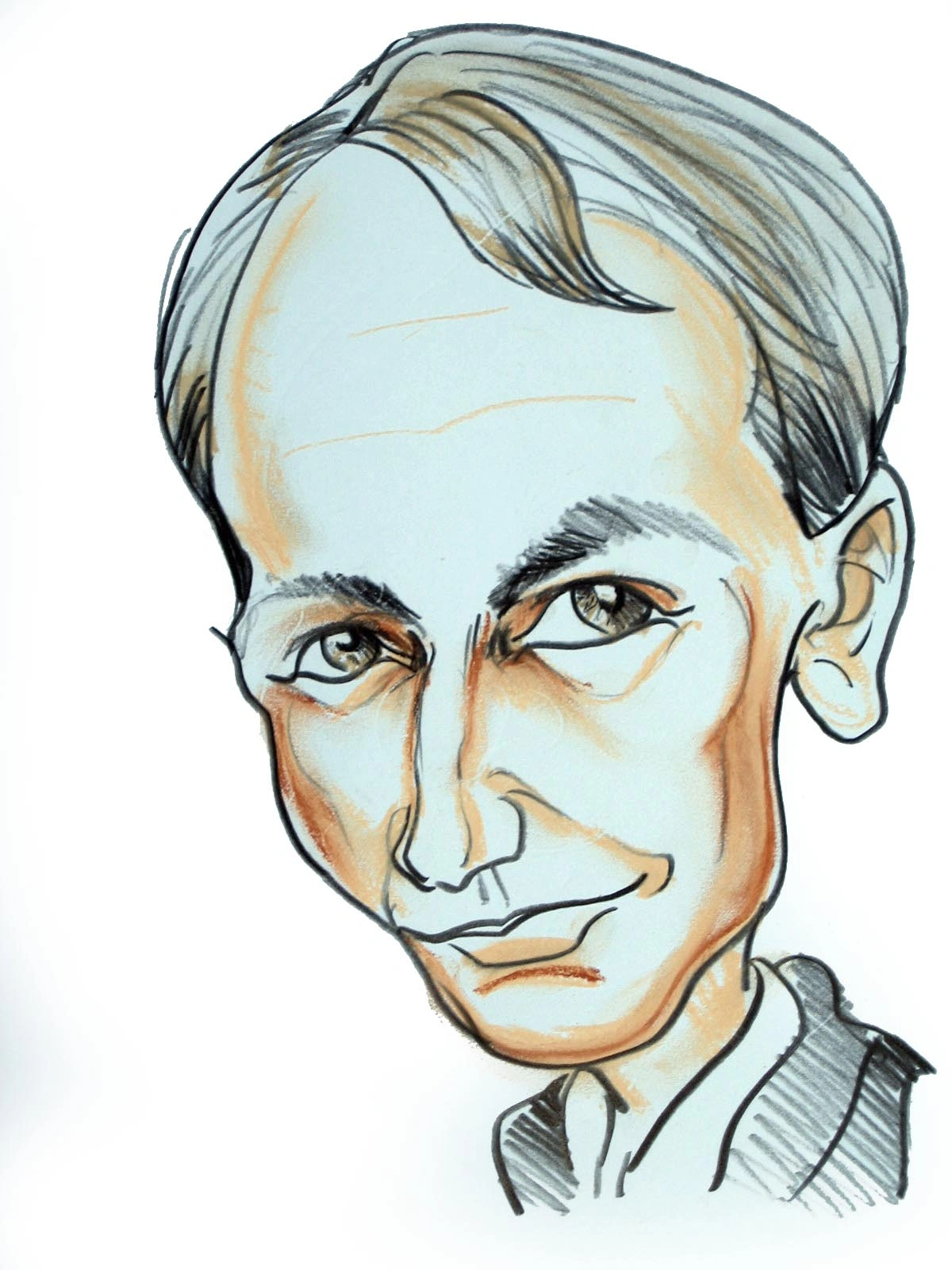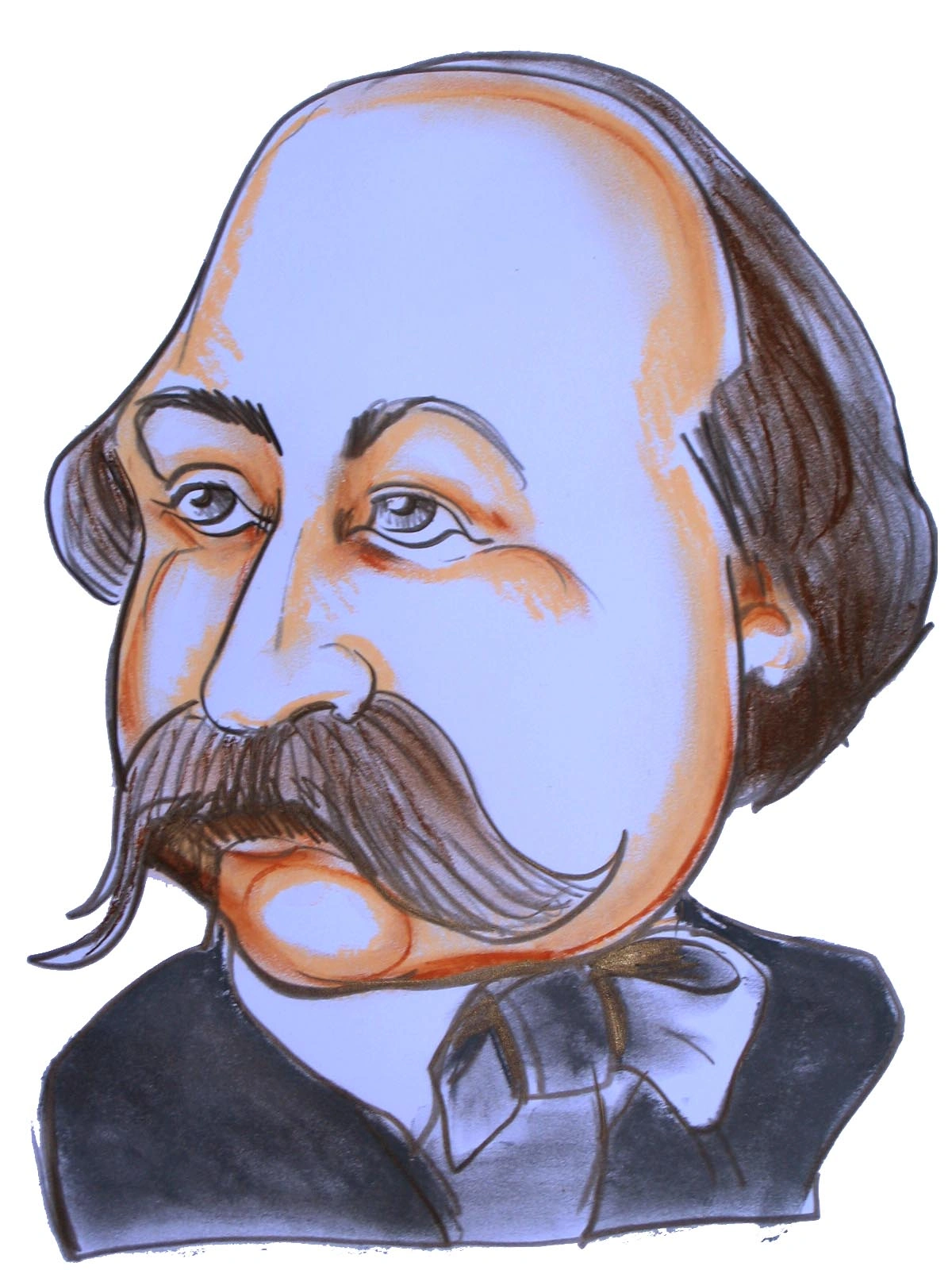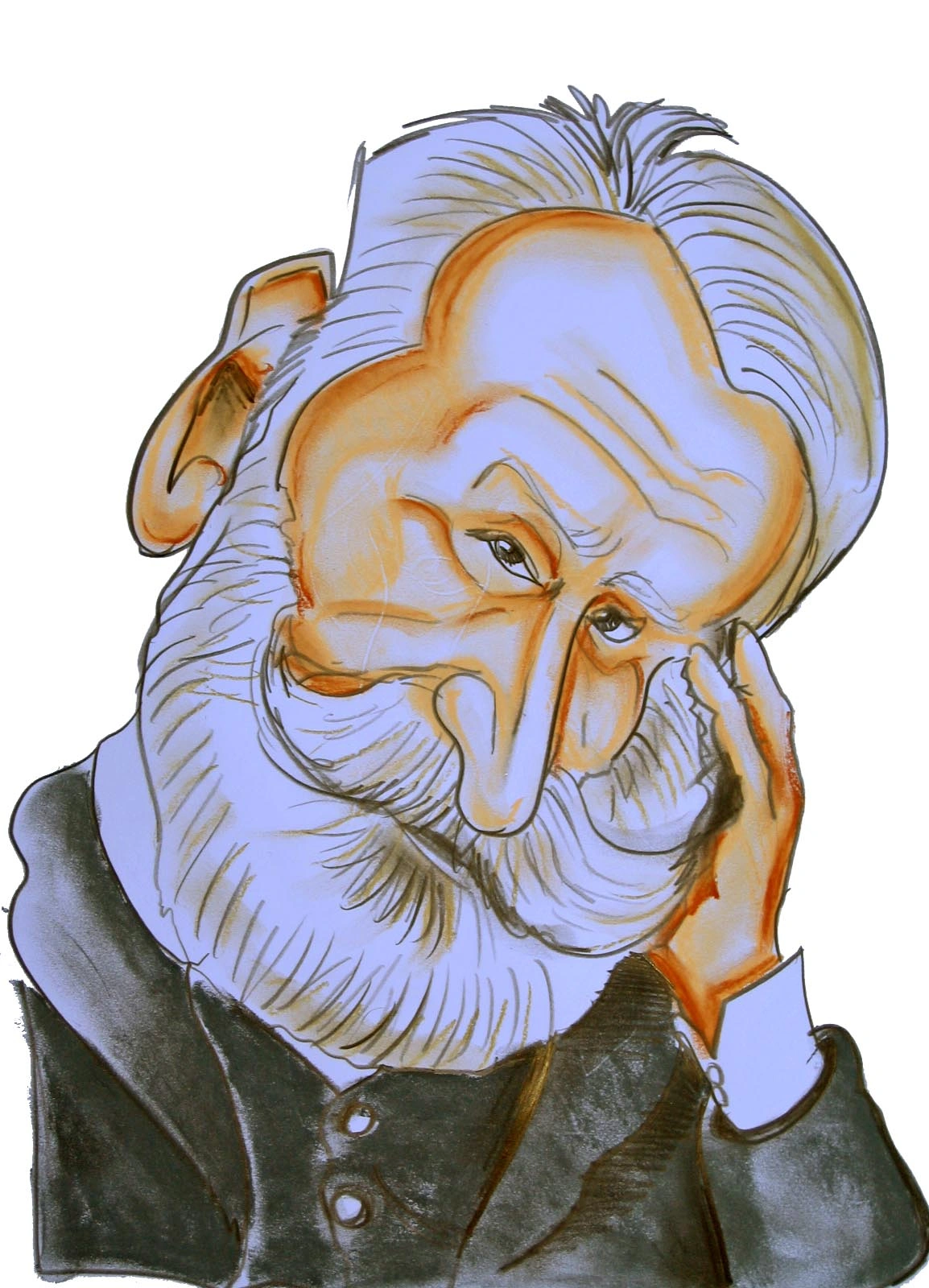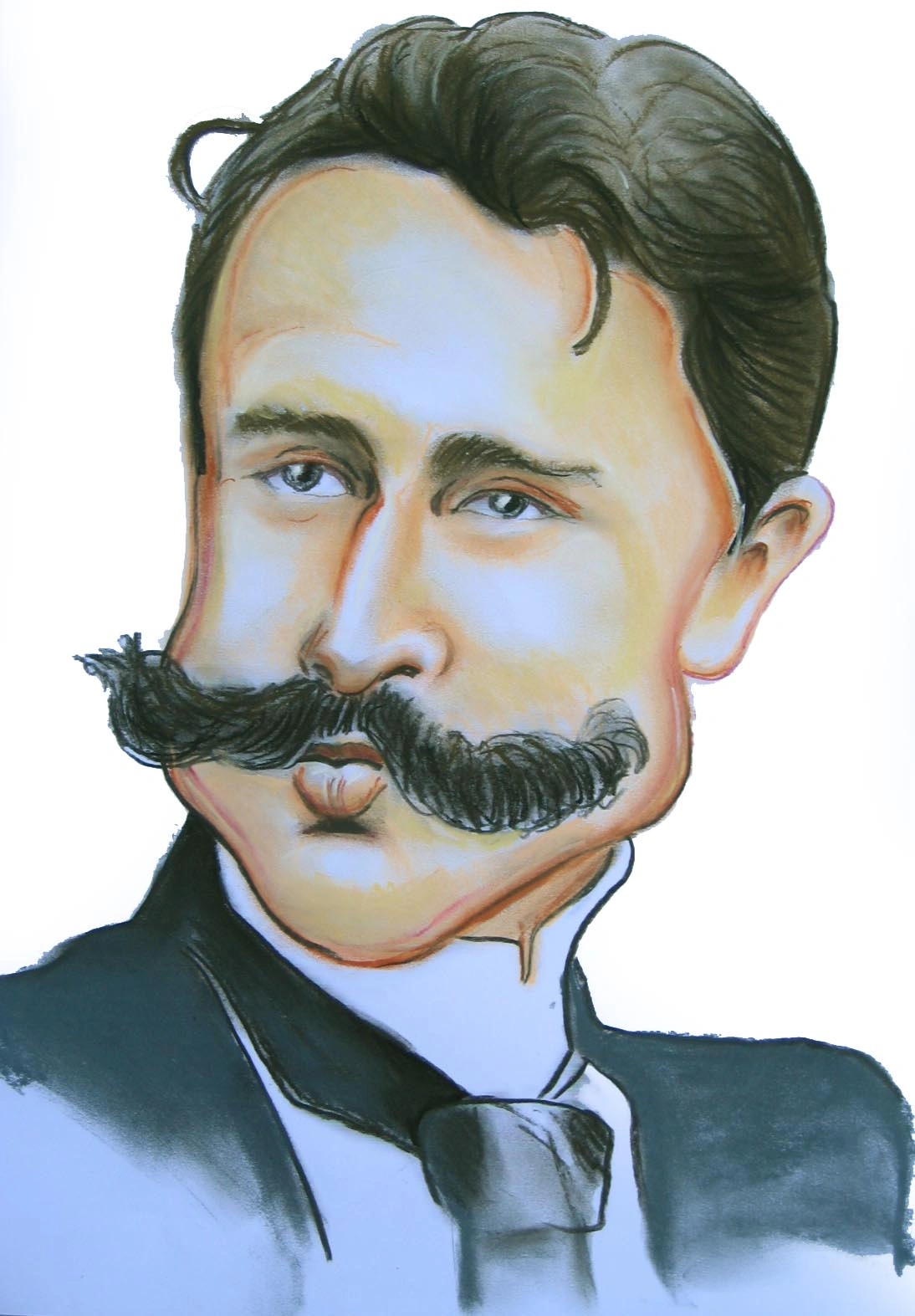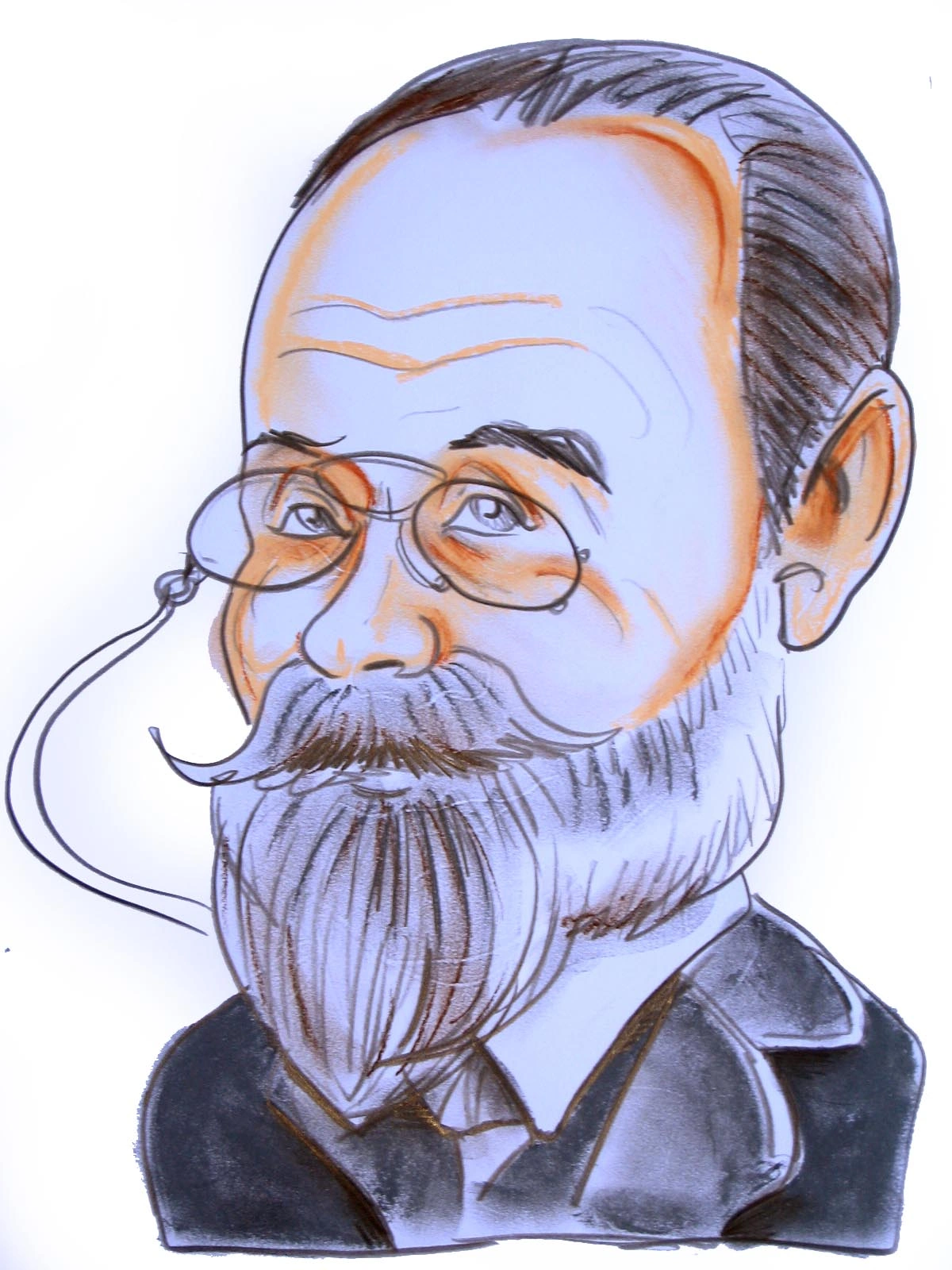1149 résultats pour "l+homme+des+sorts"
- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - L'Astrologue qui se laisse tomber dans un puits
- Corneille, Le Cid, Acte 1, scène 1.
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : L'année terrible) - A Vianden
- Chateaubriand, René
- Anatole France: La rôtisserie de la Reine Pédauque
- Jean ROBERTET (14xx-1503) - L'exposition des couleurs
- Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre LXXII
- Voltaire, Dictionnaire philosophique « Beau » :
-
- Flaminio de BIRAGUE (1550-x) - Je sens déjà saillir de toute fosse obscure
- Pierre François LACENAIRE (1803-1836) - Le dernier chant
-
Depuis le XVIIIième siècle, on affirmait la concordance des progrès techniques et du progrès moral. Pensez-vous qu'on ait des raisons aujourd'hui de la remettre en cause ?
Pour la plupart des philosophes du XVIIIe siècle, le progrès scientifique et technique qu'ils appelaient d e leurs vœux devait nécessairement s'accompagner d'un progrès moral d e l'humanité tout entière, le second étant d'ailleurs conditionné par le premier. À chaque pas accompli par l'homme dans le champ du savoir, à chaque progrès de l'esprit, devait logiquement correspondre une évolution positive dans le domaine des mœurs. Les penseurs des Lumières comptaient ainsi sur le génie scientifique p...
-
Poème extrait de La légende des siècles « Orphée » - Victor HUGO
Poème extrait de La légende des siècles « Orphée » "J'atteste Tanaïs, le fleuve noir aux six urnes, Et Zeus qui fait traîner sur les grands chars nocturnes Rhéa par des taureaux et Nyx par des chevaux Et les anciens géants et les hommes nouveaux, Pluton qui nous dévore, Uranus qui nous crée, Que j'adore une femme et qu'elle m'est sacrée. Le monstre aux cheveux bleus, Poséidon, m'entend; Qu'il m'exauce. Je suis l'âme humaine chantant, Et j'aime. L'ombre immense est pleine de nuées, La large plui...
- Nicolas BOILEAU (1636-1711) (Recueil : Le lutrin) - Chant premier
- Louis Aragon, Le Paysan de Paris (1926).
- Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard, acte II, scène 12.
- Zola, l'Assommoir, chapitre 10 - Au milieu de cette existence enragée par la misère...
-
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, Partie I.
- Paul Claudel, l'Échange
-
« Toute lecture est d'abord une évasion. Mais il y a mille façons de s'évader et l'essentiel est de savoir de quoi et vers quoi on s'évade. » Robert Escarpit, Sociologie de la littérature.
« Toute lecture est d'abord une évasion. Mais il y a mille façons de s'évader et l'essentiel est de savoir de quoi et vers quoi on s'évade. » Robert Escarpit, Sociologie de la littérature. La lecture confère au livre une existence. M. Tournier : « Un livre écrit, mais non lu, n'existe pas pleinement... L'écrivain le sait et lorsqu'il publie un livre, il lâche dans la foule anonyme des hommes et des femmes une nuée d'oiseaux de papier, des vampires secs assoiffés de sang, qui se répandent au hasa...
-
Montaigne écrit, dans le livre II de ses Essais : « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. » Pensez-vous que l'on puisse définir ainsi toute entreprise autobiographique ?
Analyse du sujet et problématisation Ce sujet invite à réfléchir sur la définition de l'autobiographie que donne Montaigne et à la discuter. Cette définition, construite sur un chiasme, montre que l'entreprise autobiographique est une construction de soi : en écrivant son livre, l'autobiographe approfondit sa connaissance de soi et construit sa personnalité. Il y a un effet rétroactif de l'écriture autobiographique sur l'autobiographe. Mais en disant que son livre l' « a fait » Montaigne montre...
- Hervé Bazin, Vipère au poing.
- Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) (Recueil : Méditations poétiques) - La gloire
- Molière, Le Misanthrope, acte V, scène dernière
- Guy de Maupassant, Bel-Ami, I, 3.
-
- Pagnol, La Gloire de mon père.
- Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe
-
L'HUMANISME (XVIe siècle)
L'HUMANISME (XVIe siècle) Apparue dès le XIVe siècle en Italie, la Renaissance littéraire gagne la France à la fin du XVe, sous l'influence de professeurs et d'étudiants venus travailler dans les universités italiennes. Ils en rapportent le goût des lettres anciennes et la passion de l'Antiquité. C'est ainsi qu'un des premiers ouvrages sortis de l'imprimerie de la Sorbonne, la Rhétorique, de Guillaume Fichet, affirme l'objectif d'enseigner «l'art de bien dire» puisé «à la source féconde du génie...
- Shakespeare, Hamlet, Acte I, scène V (La révélation du Spectre)
- Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, I, VII, 2.
-
Friedrich Hölderlin
Friedrich Hölderlin Dans les histoires de la littérature allemande écrites au XIXe siècle, le nom de Hölderlin si toutefois il y figure n'apparaît que, tout au plus, dans quelque note marginale. C e poète passait alors pour un imitateur de Schiller, un fanatique de la Grèce antique, auteur d e vers délirants et amorphes, auquel, cependant, quelques accents émouvants avaient échappé, avant qu'il ne sombrât dans la démence. Abstraction faite de quelques admirateurs isolés, il a fallu attendre notr...
- Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves - Première partie
- Victor Hugo, Hernani, acte I, scène 2.
-
- Balzac, Le Cousin Pons, chapitre 57.
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, Acte II, scène 19
- Zola, Thérèse Raquin, chapitre 21
- Balzac, Le Colonel Chabert.
- Alfred de Musset, La Confession d'un enfant du siècle, 1836.
- Émile VERHAEREN (1855-1916) (Recueil : Les ailes rouges de la guerre) - Ceux de Liége
- Théophile de VIAU (1590-1626) - Le matin
-
L'art est un mensonge qui dit la vérité. Commentez et discutez ces propos. ?
L'art est un domaine spécifique de la production humaine. En effet, au départ, il était inclus dans le mot techne qui signifie savoir-faire. Cependant il se détache progressivement des autres savoirs-faire, dans la mesure où il ne vise aucune production efficace, aucune productivité. Kant disait que l'œuvre d'art était une finalité sans fin alors que les autres techniques sont un moyen pour satisfaire l'homme. Mais ce qu'il s'agit d'interroger ici, c'est le rapport de l'art à la réalité et à la...
-
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - Les oiseaux
- Émile Zola, L'Assommoir, chapitre XIII.
-
Charles-Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894) (Recueil : Poèmes antiques) - La mort de Valmiki
Intro : Ce passage est extrait de « la mort de Valmiki » de Leconte de Lisle. Ce poème est issu du recueil Les poèmes antiques, paru en 1852 après que l’auteur eût renoncé à la vie politique française, déçu par les évènements de 1848. Chef de file de l’école parnassienne, il préconise une poésie objective qui réunisse la science et l’art. Dans ce poème en alexandrin, le poète rapporte la mort du poète mythique Valmiki, sage indien auteur d’un long poème épique. Problématique : Nous pouvons nous...
- Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre XV
- Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Les Odes) - Contre Denise Sorcière
- Alfred de Musset, Lorenzaccio, acte IV, scène 9.
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : L'art d'être grand-père) - Un manque
- Molière (1622-1673), L'Avare (1668), Acte II, scène 5.
-
- Jules LEFÈVRE-DEUMIER (1797-1857) - La fleur fossile
- Jacques DAVY DU PERRON (1555-1618) - Quand le flambeau du monde