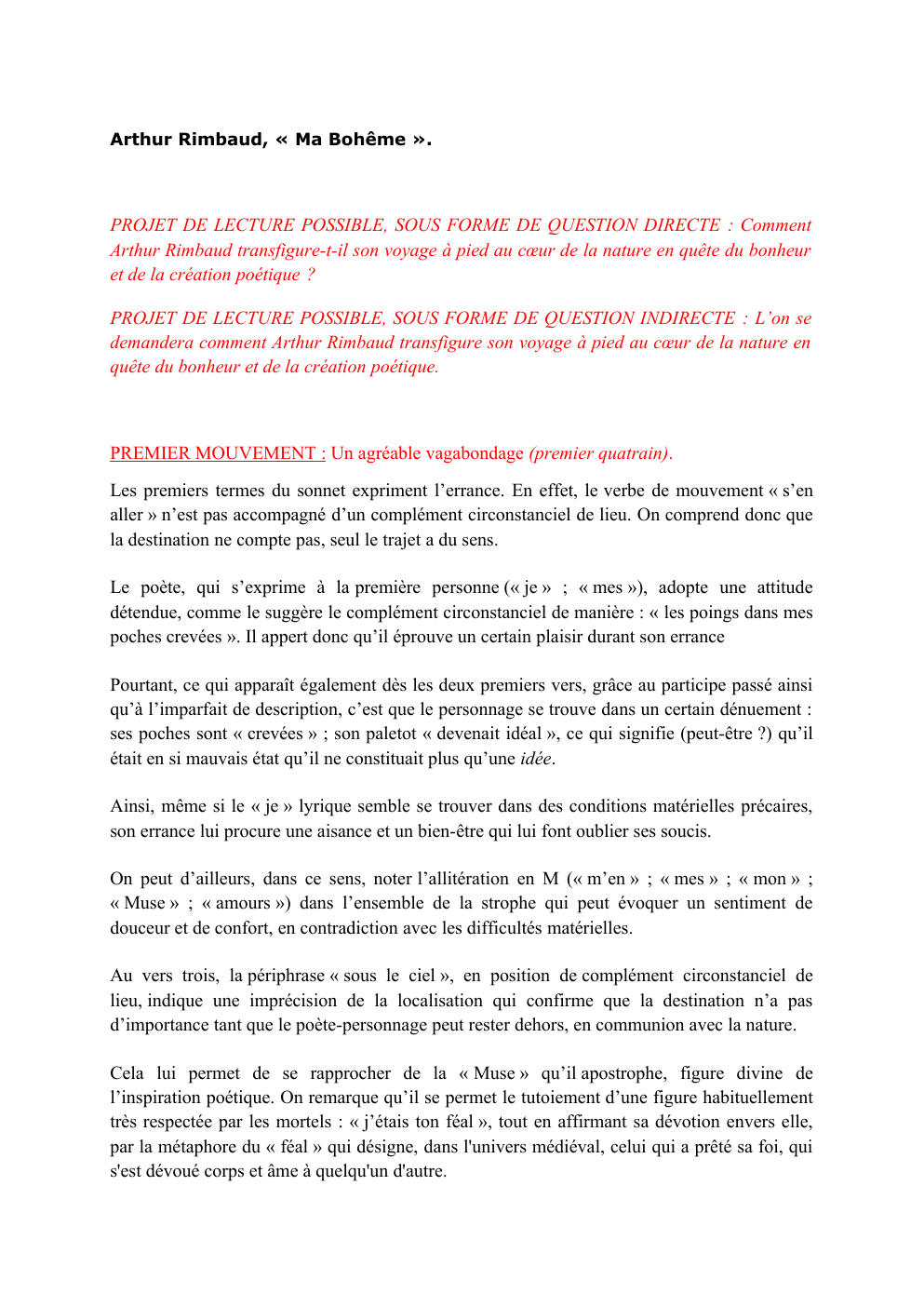Corrigé_Explication linéaire_Ma Bohême
Publié le 18/05/2025
Extrait du document
«
Arthur Rimbaud, « Ma Bohême ».
PROJET DE LECTURE POSSIBLE, SOUS FORME DE QUESTION DIRECTE : Comment
Arthur Rimbaud transfigure-t-il son voyage à pied au cœur de la nature en quête du bonheur
et de la création poétique ?
PROJET DE LECTURE POSSIBLE, SOUS FORME DE QUESTION INDIRECTE : L’on se
demandera comment Arthur Rimbaud transfigure son voyage à pied au cœur de la nature en
quête du bonheur et de la création poétique.
PREMIER MOUVEMENT : Un agréable vagabondage (premier quatrain).
Les premiers termes du sonnet expriment l’errance.
En effet, le verbe de mouvement « s’en
aller » n’est pas accompagné d’un complément circonstanciel de lieu.
On comprend donc que
la destination ne compte pas, seul le trajet a du sens.
Le poète, qui s’exprime à la première personne (« je » ; « mes »), adopte une attitude
détendue, comme le suggère le complément circonstanciel de manière : « les poings dans mes
poches crevées ».
Il appert donc qu’il éprouve un certain plaisir durant son errance
Pourtant, ce qui apparaît également dès les deux premiers vers, grâce au participe passé ainsi
qu’à l’imparfait de description, c’est que le personnage se trouve dans un certain dénuement :
ses poches sont « crevées » ; son paletot « devenait idéal », ce qui signifie (peut-être ?) qu’il
était en si mauvais état qu’il ne constituait plus qu’une idée.
Ainsi, même si le « je » lyrique semble se trouver dans des conditions matérielles précaires,
son errance lui procure une aisance et un bien-être qui lui font oublier ses soucis.
On peut d’ailleurs, dans ce sens, noter l’allitération en M (« m’en » ; « mes » ; « mon » ;
« Muse » ; « amours ») dans l’ensemble de la strophe qui peut évoquer un sentiment de
douceur et de confort, en contradiction avec les difficultés matérielles.
Au vers trois, la périphrase « sous le ciel », en position de complément circonstanciel de
lieu, indique une imprécision de la localisation qui confirme que la destination n’a pas
d’importance tant que le poète-personnage peut rester dehors, en communion avec la nature.
Cela lui permet de se rapprocher de la « Muse » qu’il apostrophe, figure divine de
l’inspiration poétique.
On remarque qu’il se permet le tutoiement d’une figure habituellement
très respectée par les mortels : « j’étais ton féal », tout en affirmant sa dévotion envers elle,
par la métaphore du « féal » qui désigne, dans l'univers médiéval, celui qui a prêté sa foi, qui
s'est dévoué corps et âme à quelqu'un d'autre.
Cette légère impertinence illustre parfaitement l’anticonformisme du jeune Rimbaud, mais
également la relation privilégiée qu’il noue, simultanément, avec la nature et la poésie.
Ce tutoiement peut également être lu comme une forme d’allégresse consécutive à la jeunesse
du poète.
Cette lecture se confirme grâce aux exclamations du vers suivant, ponctuées par une
locution interjective : « Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées ! »
On voit très bien que le poète-personnage se laisse emporter par sa fougue et le bonheur qu’il
ressent à errer librement dans la nature.
Enfin, si l’on observe les deux mots à la rime des vers un et quatre : « crevées » / « rêvées »,
on peut en déduire que le pouvoir de l’imagination parvient à remplacer les contraintes
matérielles.
En effet, ses « poches crevées » (donc, tangibles) laissent leur place à des
« amours splendides (…) rêvées » (donc, fantasmées)
De facto, dans cette strophe, le poète nous livre l’image d’un personnage dénué de tout bien,
mais heureux dans la simplicité et la liberté de son errance.
DEUXIÈME MOUVEMENT : Une marche à pied au contact de la nature qui stimule
l’imagination (second quatrain et premier tercet).
Le premier vers de la seconde strophe vient d’ailleurs confirmer, sur le plan vestimentaire,
cette précarité matérielle : « mon unique culotte avait un large trou ».
Le personnage ne
possède qu’une seule culotte, trouée, qui plus est.
La métaphore du « Petit-Poucet rêveur » au vers suivant est intéressante, car elle file le thème
de l’indigence tout en introduisant l’idée selon laquelle la poésie, représentée par la
synecdoque particularisante des « rimes », permet de guider le poète.
Dans le conte original, écrit par Charles Perrault, le Petit-Poucet sème des miettes de pain
pour retrouver son chemin.
Ici, le poète laisse derrière lui « des rimes », comme pour laisser
une trace poétique de son passage sur terre.
Il insiste sur ce détail, en le plaçant au centre du
sonnet (vers sept sur quatre), et en le mettant en exergue grâce à un rejet (réalisé par un
enjambement).
Donc, comme le Petit-Poucet, Arthur Rimbaud a fui sa famille.
Notons, au passage, que la
référence au conte de Perrault confère un aspect autobiographique au texte.
Mais il laisse
derrière lui quelque chose de bien plus durable que des miettes de pain : de la poésie.
Au
chemin visible du Petit-Poucet pour se raccorder à sa famille, se substitue le chemin
« invisible » et intérieur du poète, pour sa raccorder à sa propre créativité poétique.
On retrouve, dans cette strophe, l’allégresse euphorique du premier quatrain.
En effet, le poète
fait allusion à sa « course », comme s’il courait sans objectif précis.
La métaphore du vers sept « Mon auberge était à la Grande-Ourse » laisse penser qu’il dort à
la belle étoile.
Le « je » lyrique accentue ainsi à la fois le sentiment de liberté et l’idée de
relation intime avec la nature, qui lui offre un abri pour la nuit.
Cependant, le fait de dormir dehors, au contact du cosmos, lui permet surtout de trouver
l’inspiration poétique.
Il s’approprie la nature, comme on le voit par le moyen de ce groupe
nominal : « Mes étoiles » ; le déterminant possessif de première personne du singulier montre
qu’il se sent en harmonie avec le ciel.
Le fait qu’il évoque les étoiles, normalement perçues avec la vue, grâce au toucher (« un doux
frou-frou »), puis grâce à l’ouïe (« Et je les écoutais… », vers neuf) prouve que Rimbaud est
capable de percevoir et de ressentir les choses différemment.
Notons d’ailleurs que
l’assonance en OU introduit le sens de l’ouïe au vers neuf, grâce à l’imparfait de description.
Il s’agit là de la mission créatrice du poète : la réalisation de correspondances insolites entre
les sens et l’expression, grâce au langage poétique, d’une perception singulière du réel qui
dépasse ce que le commun des mortels peut voir.
Le premier tercet démarre en continuité directe du second quatrain.
Il s’agit de la même
phrase,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication linéaire n°10 : Le portrait de M. de Rênal, ou le type du bourgeois de province (I, 1)
- De l’explication linéaire au commentaire composé On Purge bébé, (scène II) Georges Feydeau, 1910
- Lecture linéaire de Giton : Les caractères de la Bruyère
- Etude linéaire Le Prologue JUSTE LA FIN DU MONDE (2)
- Stendhal Le Rouge et le Noir: Lecture linéaire : Texte n°3, Livre II, chapitre XLV : de : « [Fouqué] passait la nuit seul » à la fin du chapitre