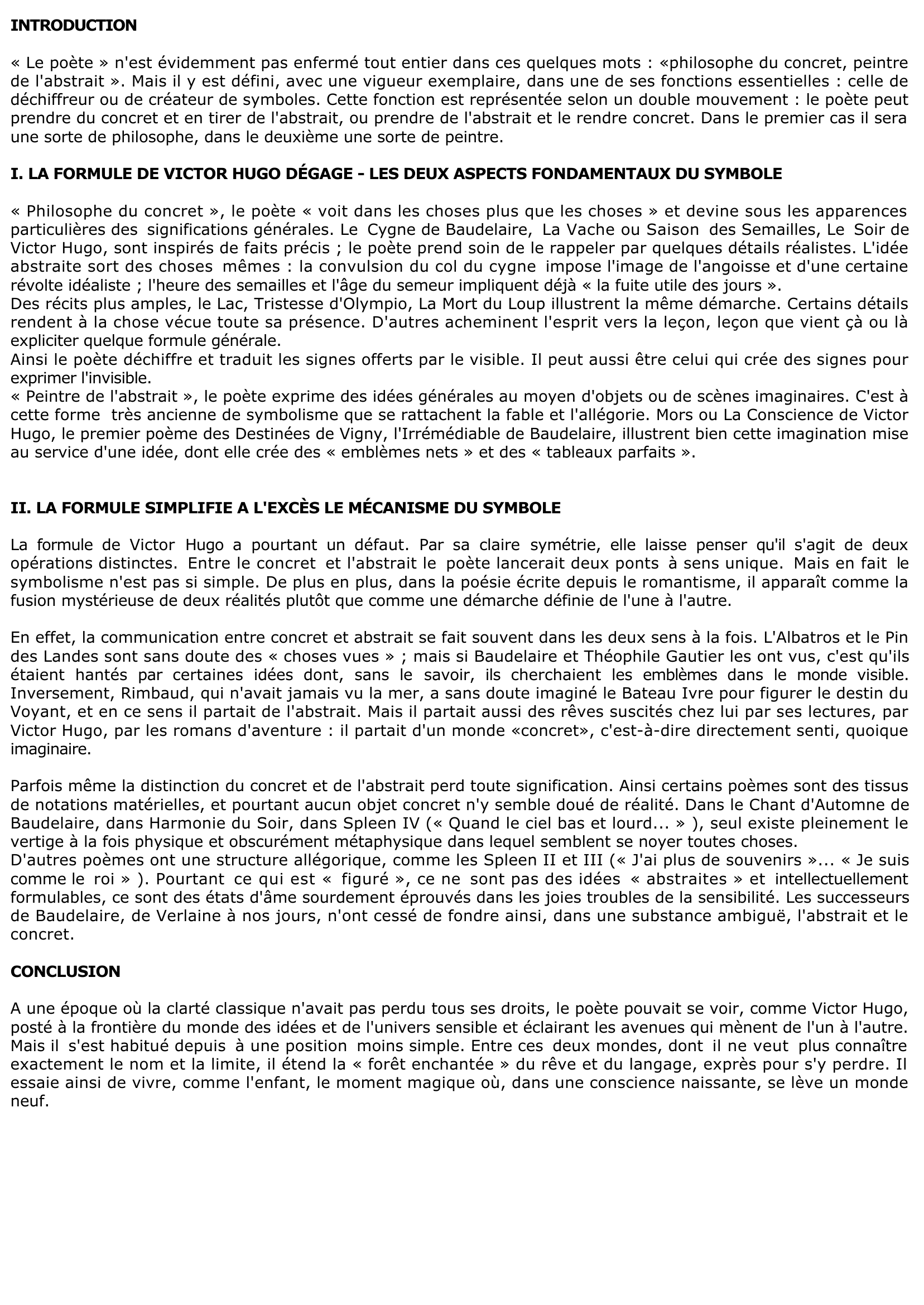Commentez cette formule de Victor Hugo : « Le poète, ce philosophe du concret et ce peintre de l'abstrait ».
Extrait du document
«
INTRODUCTION
« Le poète » n'est évidemment pas enfermé tout entier dans ces quelques mots : «philosophe du concret, peintre
de l'abstrait ».
Mais il y est défini, avec une vigueur exemplaire, dans une de ses fonctions essentielles : celle de
déchiffreur ou de créateur de symboles.
Cette fonction est représentée selon un double mouvement : le poète peut
prendre du concret et en tirer de l'abstrait, ou prendre de l'abstrait et le rendre concret.
Dans le premier cas il sera
une sorte de philosophe, dans le deuxième une sorte de peintre.
I.
LA FORMULE DE VICTOR HUGO DÉGAGE - LES DEUX ASPECTS FONDAMENTAUX DU SYMBOLE
« Philosophe du concret », le poète « voit dans les choses plus que les choses » et devine sous les apparences
particulières des significations générales.
Le Cygne de Baudelaire, La Vache ou Saison des Semailles, Le Soir de
Victor Hugo, sont inspirés de faits précis ; le poète prend soin de le rappeler par quelques détails réalistes.
L'idée
abstraite sort des choses mêmes : la convulsion du col du cygne impose l'image de l'angoisse et d'une certaine
révolte idéaliste ; l'heure des semailles et l'âge du semeur impliquent déjà « la fuite utile des jours ».
Des récits plus amples, le Lac, Tristesse d'Olympio, La Mort du Loup illustrent la même démarche.
Certains détails
rendent à la chose vécue toute sa présence.
D'autres acheminent l'esprit vers la leçon, leçon que vient çà ou là
expliciter quelque formule générale.
Ainsi le poète déchiffre et traduit les signes offerts par le visible.
Il peut aussi être celui qui crée des signes pour
exprimer l'invisible.
« Peintre de l'abstrait », le poète exprime des idées générales au moyen d'objets ou de scènes imaginaires.
C'est à
cette forme très ancienne de symbolisme que se rattachent la fable et l'allégorie.
Mors ou La Conscience de Victor
Hugo, le premier poème des Destinées de Vigny, l'Irrémédiable de Baudelaire, illustrent bien cette imagination mise
au service d'une idée, dont elle crée des « emblèmes nets » et des « tableaux parfaits ».
II.
LA FORMULE SIMPLIFIE A L'EXCÈS LE MÉCANISME DU SYMBOLE
La formule de Victor Hugo a pourtant un défaut.
Par sa claire symétrie, elle laisse penser qu'il s'agit de deux
opérations distinctes.
Entre le concret et l'abstrait le poète lancerait deux ponts à sens unique.
Mais en fait le
symbolisme n'est pas si simple.
De plus en plus, dans la poésie écrite depuis le romantisme, il apparaît comme la
fusion mystérieuse de deux réalités plutôt que comme une démarche définie de l'une à l'autre.
En effet, la communication entre concret et abstrait se fait souvent dans les deux sens à la fois.
L'Albatros et le Pin
des Landes sont sans doute des « choses vues » ; mais si Baudelaire et Théophile Gautier les ont vus, c'est qu'ils
étaient hantés par certaines idées dont, sans le savoir, ils cherchaient les emblèmes dans le monde visible.
Inversement, Rimbaud, qui n'avait jamais vu la mer, a sans doute imaginé le Bateau Ivre pour figurer le destin du
Voyant, et en ce sens il partait de l'abstrait.
Mais il partait aussi des rêves suscités chez lui par ses lectures, par
Victor Hugo, par les romans d'aventure : il partait d'un monde «concret», c'est-à-dire directement senti, quoique
imaginaire.
Parfois même la distinction du concret et de l'abstrait perd toute signification.
Ainsi certains poèmes sont des tissus
de notations matérielles, et pourtant aucun objet concret n'y semble doué de réalité.
Dans le Chant d'Automne de
Baudelaire, dans Harmonie du Soir, dans Spleen IV (« Quand le ciel bas et lourd...
» ), seul existe pleinement le
vertige à la fois physique et obscurément métaphysique dans lequel semblent se noyer toutes choses.
D'autres poèmes ont une structure allégorique, comme les Spleen II et III (« J'ai plus de souvenirs »...
« Je suis
comme le roi » ).
Pourtant ce qui est « figuré », ce ne sont pas des idées « abstraites » et intellectuellement
formulables, ce sont des états d'âme sourdement éprouvés dans les joies troubles de la sensibilité.
Les successeurs
de Baudelaire, de Verlaine à nos jours, n'ont cessé de fondre ainsi, dans une substance ambiguë, l'abstrait et le
concret.
CONCLUSION
A une époque où la clarté classique n'avait pas perdu tous ses droits, le poète pouvait se voir, comme Victor Hugo,
posté à la frontière du monde des idées et de l'univers sensible et éclairant les avenues qui mènent de l'un à l'autre.
Mais il s'est habitué depuis à une position moins simple.
Entre ces deux mondes, dont il ne veut plus connaître
exactement le nom et la limite, il étend la « forêt enchantée » du rêve et du langage, exprès pour s'y perdre.
Il
essaie ainsi de vivre, comme l'enfant, le moment magique où, dans une conscience naissante, se lève un monde
neuf..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Odes et ballades) - Le poète dans les révolutions
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les rayons et les ombres) - Fonction du poète
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - Le poète s'en va dans les champs
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - Il faut que le poète
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les contemplations) - A un poète aveugle