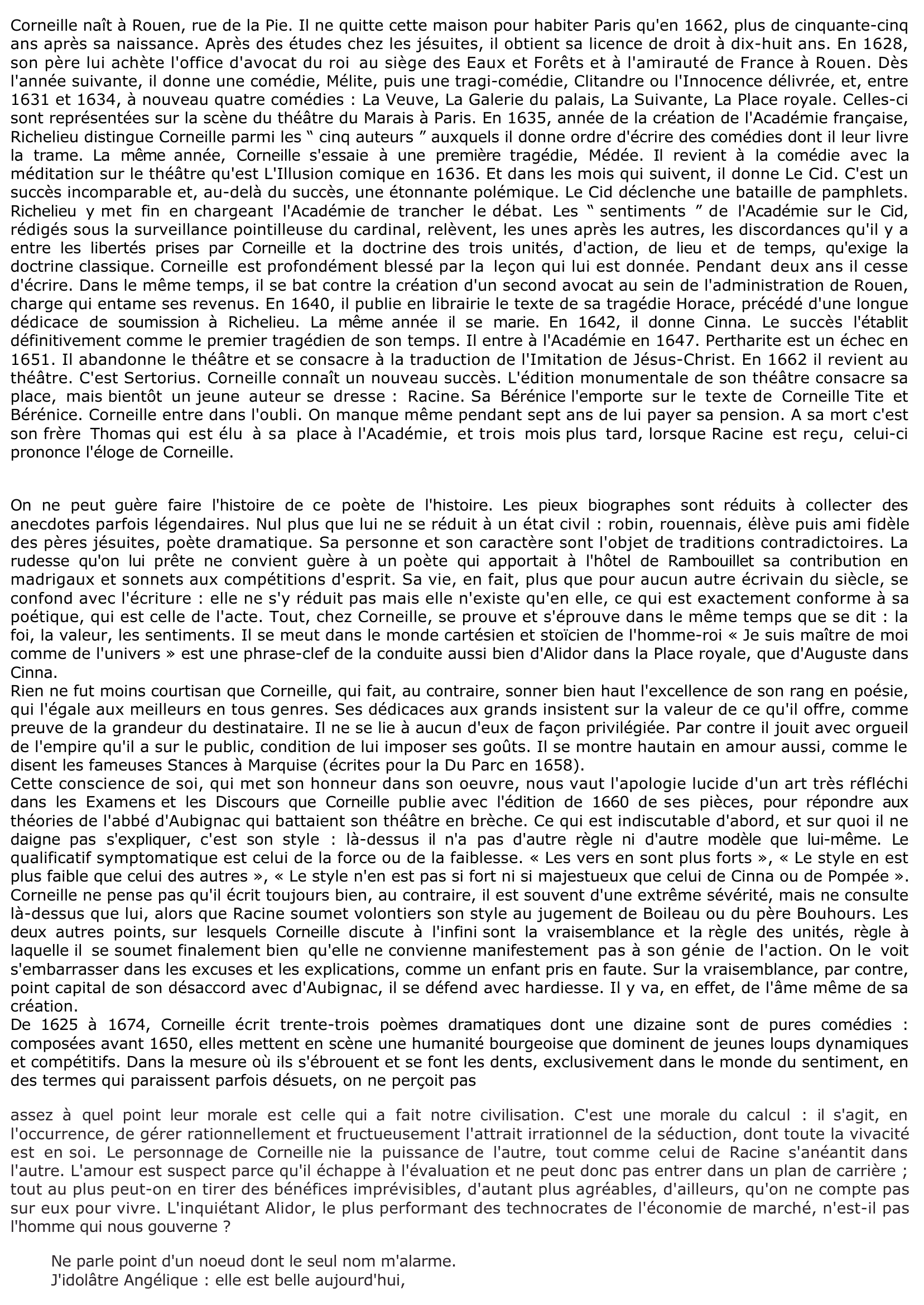PIERRE CORNEILLE
Extrait du document
«
Corneille naît à Rouen, rue de la Pie.
Il ne quitte cette maison pour habiter Paris qu'en 1662, plus de cinquante-cinq
ans après sa naissance.
Après des études chez les jésuites, il obtient sa licence de droit à dix-huit ans.
En 1628,
son père lui achète l'office d'avocat du roi au siège des Eaux et Forêts et à l'amirauté de France à Rouen.
Dès
l'année suivante, il donne une comédie, Mélite, puis une tragi-comédie, Clitandre ou l'Innocence délivrée, et, entre
1631 et 1634, à nouveau quatre comédies : La Veuve, La Galerie du palais, La Suivante, La Place royale.
Celles-ci
sont représentées sur la scène du théâtre du Marais à Paris.
En 1635, année de la création de l'Académie française,
Richelieu distingue Corneille parmi les “ cinq auteurs ” auxquels il donne ordre d'écrire des comédies dont il leur livre
la trame.
La même année, Corneille s'essaie à une première tragédie, Médée.
Il revient à la comédie avec la
méditation sur le théâtre qu'est L'Illusion comique en 1636.
Et dans les mois qui suivent, il donne Le Cid.
C'est un
succès incomparable et, au-delà du succès, une étonnante polémique.
Le Cid déclenche une bataille de pamphlets.
Richelieu y met fin en chargeant l'Académie de trancher le débat.
Les “ sentiments ” de l'Académie sur le Cid,
rédigés sous la surveillance pointilleuse du cardinal, relèvent, les unes après les autres, les discordances qu'il y a
entre les libertés prises par Corneille et la doctrine des trois unités, d'action, de lieu et de temps, qu'exige la
doctrine classique.
Corneille est profondément blessé par la leçon qui lui est donnée.
Pendant deux ans il cesse
d'écrire.
Dans le même temps, il se bat contre la création d'un second avocat au sein de l'administration de Rouen,
charge qui entame ses revenus.
En 1640, il publie en librairie le texte de sa tragédie Horace, précédé d'une longue
dédicace de soumission à Richelieu.
La même année il se marie.
En 1642, il donne Cinna.
Le succès l'établit
définitivement comme le premier tragédien de son temps.
Il entre à l'Académie en 1647.
Pertharite est un échec en
1651.
Il abandonne le théâtre et se consacre à la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ.
En 1662 il revient au
théâtre.
C'est Sertorius.
Corneille connaît un nouveau succès.
L'édition monumentale de son théâtre consacre sa
place, mais bientôt un jeune auteur se dresse : Racine.
Sa Bérénice l'emporte sur le texte de Corneille Tite et
Bérénice.
Corneille entre dans l'oubli.
On manque même pendant sept ans de lui payer sa pension.
A sa mort c'est
son frère Thomas qui est élu à sa place à l'Académie, et trois mois plus tard, lorsque Racine est reçu, celui-ci
prononce l'éloge de Corneille.
On ne peut guère faire l'histoire de ce poète de l'histoire.
Les pieux biographes sont réduits à collecter des
anecdotes parfois légendaires.
Nul plus que lui ne se réduit à un état civil : robin, rouennais, élève puis ami fidèle
des pères jésuites, poète dramatique.
Sa personne et son caractère sont l'objet de traditions contradictoires.
La
rudesse qu'on lui prête ne convient guère à un poète qui apportait à l'hôtel de Rambouillet sa contribution en
madrigaux et sonnets aux compétitions d'esprit.
Sa vie, en fait, plus que pour aucun autre écrivain du siècle, se
confond avec l'écriture : elle ne s'y réduit pas mais elle n'existe qu'en elle, ce qui est exactement conforme à sa
poétique, qui est celle de l'acte.
Tout, chez Corneille, se prouve et s'éprouve dans le même temps que se dit : la
foi, la valeur, les sentiments.
Il se meut dans le monde cartésien et stoïcien de l'homme-roi « Je suis maître de moi
comme de l'univers » est une phrase-clef de la conduite aussi bien d'Alidor dans la Place royale, que d'Auguste dans
Cinna.
Rien ne fut moins courtisan que Corneille, qui fait, au contraire, sonner bien haut l'excellence de son rang en poésie,
qui l'égale aux meilleurs en tous genres.
Ses dédicaces aux grands insistent sur la valeur de ce qu'il offre, comme
preuve de la grandeur du destinataire.
Il ne se lie à aucun d'eux de façon privilégiée.
Par contre il jouit avec orgueil
de l'empire qu'il a sur le public, condition de lui imposer ses goûts.
Il se montre hautain en amour aussi, comme le
disent les fameuses Stances à Marquise (écrites pour la Du Parc en 1658).
Cette conscience de soi, qui met son honneur dans son oeuvre, nous vaut l'apologie lucide d'un art très réfléchi
dans les Examens et les Discours que Corneille publie avec l'édition de 1660 de ses pièces, pour répondre aux
théories de l'abbé d'Aubignac qui battaient son théâtre en brèche.
Ce qui est indiscutable d'abord, et sur quoi il ne
daigne pas s'expliquer, c'est son style : là-dessus il n'a pas d'autre règle ni d'autre modèle que lui-même.
Le
qualificatif symptomatique est celui de la force ou de la faiblesse.
« Les vers en sont plus forts », « Le style en est
plus faible que celui des autres », « Le style n'en est pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna ou de Pompée ».
Corneille ne pense pas qu'il écrit toujours bien, au contraire, il est souvent d'une extrême sévérité, mais ne consulte
là-dessus que lui, alors que Racine soumet volontiers son style au jugement de Boileau ou du père Bouhours.
Les
deux autres points, sur lesquels Corneille discute à l'infini sont la vraisemblance et la règle des unités, règle à
laquelle il se soumet finalement bien qu'elle ne convienne manifestement pas à son génie de l'action.
On le voit
s'embarrasser dans les excuses et les explications, comme un enfant pris en faute.
Sur la vraisemblance, par contre,
point capital de son désaccord avec d'Aubignac, il se défend avec hardiesse.
Il y va, en effet, de l'âme même de sa
création.
De 1625 à 1674, Corneille écrit trente-trois poèmes dramatiques dont une dizaine sont de pures comédies :
composées avant 1650, elles mettent en scène une humanité bourgeoise que dominent de jeunes loups dynamiques
et compétitifs.
Dans la mesure où ils s'ébrouent et se font les dents, exclusivement dans le monde du sentiment, en
des termes qui paraissent parfois désuets, on ne perçoit pas
assez à quel point leur morale est celle qui a fait notre civilisation.
C'est une morale du calcul : il s'agit, en
l'occurrence, de gérer rationnellement et fructueusement l'attrait irrationnel de la séduction, dont toute la vivacité
est en soi.
Le personnage de Corneille nie la puissance de l'autre, tout comme celui de Racine s'anéantit dans
l'autre.
L'amour est suspect parce qu'il échappe à l'évaluation et ne peut donc pas entrer dans un plan de carrière ;
tout au plus peut-on en tirer des bénéfices imprévisibles, d'autant plus agréables, d'ailleurs, qu'on ne compte pas
sur eux pour vivre.
L'inquiétant Alidor, le plus performant des technocrates de l'économie de marché, n'est-il pas
l'homme qui nous gouverne ?
Ne parle point d'un noeud dont le seul nom m'alarme.
J'idolâtre Angélique : elle est belle aujourd'hui,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pierre CORNEILLE (1606-1684), Rodogune , princesse des Parthes (1644) : Acte V, scène 1 : monologue de Cléopâtre
- Le monologue d'Auguste, dans Cinna de Pierre CORNEILLE. Expliquez le monologue d'Auguste, dans Cinna, Acte IV, Scène II, du vers 1121 à 1148.
- Pierre Corneille, Rodogune princesse des Parthes, acte V, scène 4.
- Pierre CORNEILLE (1606-1684) - A la Marquise
- Pierre CORNEILLE (1606-1684) - Au Roy