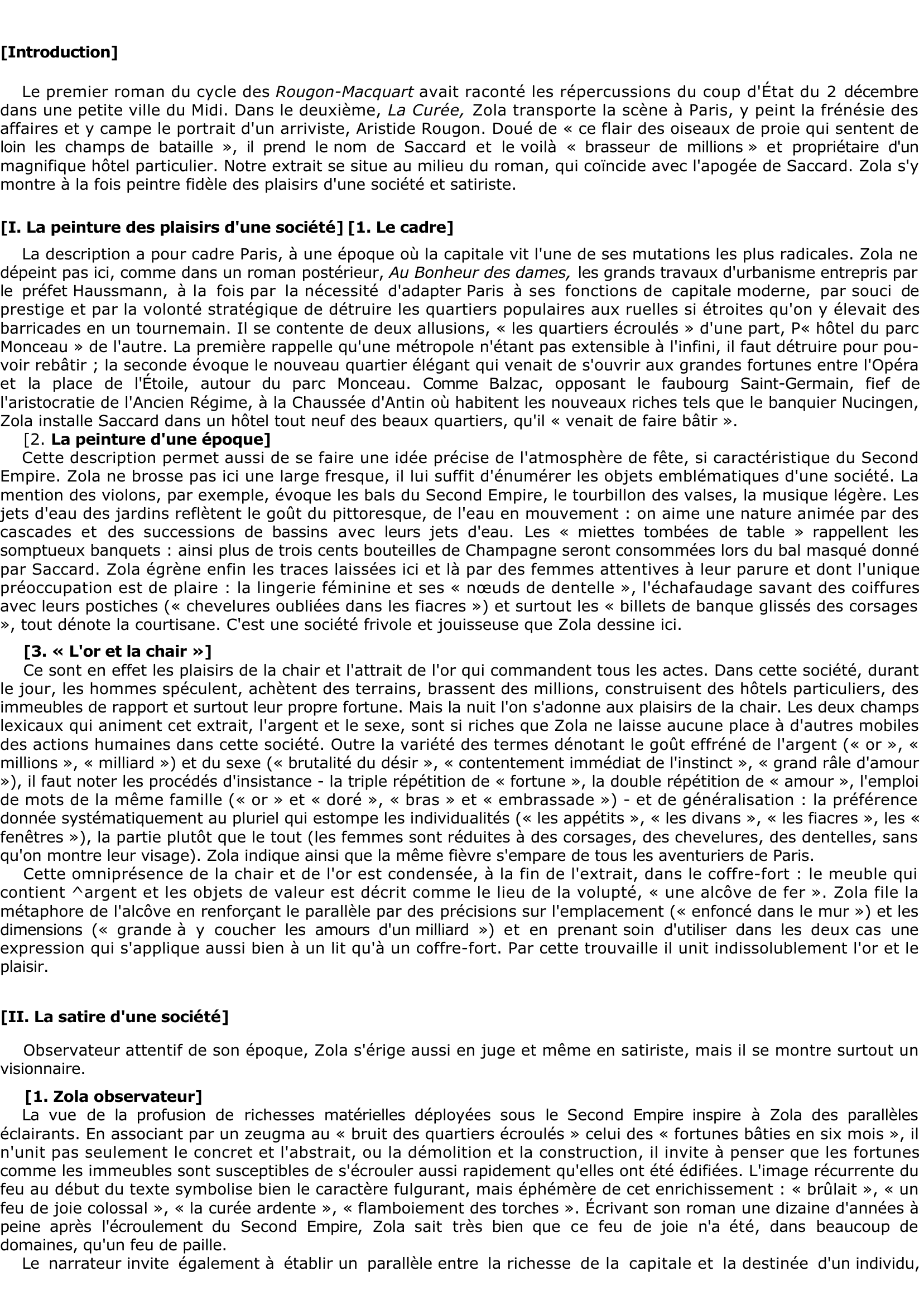Emile ZOLA, La Curée, 1871.
Extrait du document
«
[Introduction]
Le premier roman du cycle des Rougon-Macquart avait raconté les répercussions du coup d'État du 2 décembre
dans une petite ville du Midi.
Dans le deuxième, La Curée, Zola transporte la scène à Paris, y peint la frénésie des
affaires et y campe le portrait d'un arriviste, Aristide Rougon.
Doué de « ce flair des oiseaux de proie qui sentent de
loin les champs de bataille », il prend le nom de Saccard et le voilà « brasseur de millions » et propriétaire d'un
magnifique hôtel particulier.
Notre extrait se situe au milieu du roman, qui coïncide avec l'apogée de Saccard.
Zola s'y
montre à la fois peintre fidèle des plaisirs d'une société et satiriste.
[I.
La peinture des plaisirs d'une société] [1.
Le cadre]
La description a pour cadre Paris, à une époque où la capitale vit l'une de ses mutations les plus radicales.
Zola ne
dépeint pas ici, comme dans un roman postérieur, Au Bonheur des dames, les grands travaux d'urbanisme entrepris par
le préfet Haussmann, à la fois par la nécessité d'adapter Paris à ses fonctions de capitale moderne, par souci de
prestige et par la volonté stratégique de détruire les quartiers populaires aux ruelles si étroites qu'on y élevait des
barricades en un tournemain.
Il se contente de deux allusions, « les quartiers écroulés » d'une part, P« hôtel du parc
Monceau » de l'autre.
La première rappelle qu'une métropole n'étant pas extensible à l'infini, il faut détruire pour pouvoir rebâtir ; la seconde évoque le nouveau quartier élégant qui venait de s'ouvrir aux grandes fortunes entre l'Opéra
et la place de l'Étoile, autour du parc Monceau.
Comme Balzac, opposant le faubourg Saint-Germain, fief de
l'aristocratie de l'Ancien Régime, à la Chaussée d'Antin où habitent les nouveaux riches tels que le banquier Nucingen,
Zola installe Saccard dans un hôtel tout neuf des beaux quartiers, qu'il « venait de faire bâtir ».
[2.
La peinture d'une époque]
Cette description permet aussi de se faire une idée précise de l'atmosphère de fête, si caractéristique du Second
Empire.
Zola ne brosse pas ici une large fresque, il lui suffit d'énumérer les objets emblématiques d'une société.
La
mention des violons, par exemple, évoque les bals du Second Empire, le tourbillon des valses, la musique légère.
Les
jets d'eau des jardins reflètent le goût du pittoresque, de l'eau en mouvement : on aime une nature animée par des
cascades et des successions de bassins avec leurs jets d'eau.
Les « miettes tombées de table » rappellent les
somptueux banquets : ainsi plus de trois cents bouteilles de Champagne seront consommées lors du bal masqué donné
par Saccard.
Zola égrène enfin les traces laissées ici et là par des femmes attentives à leur parure et dont l'unique
préoccupation est de plaire : la lingerie féminine et ses « nœuds de dentelle », l'échafaudage savant des coiffures
avec leurs postiches (« chevelures oubliées dans les fiacres ») et surtout les « billets de banque glissés des corsages
», tout dénote la courtisane.
C'est une société frivole et jouisseuse que Zola dessine ici.
[3.
« L'or et la chair »]
Ce sont en effet les plaisirs de la chair et l'attrait de l'or qui commandent tous les actes.
Dans cette société, durant
le jour, les hommes spéculent, achètent des terrains, brassent des millions, construisent des hôtels particuliers, des
immeubles de rapport et surtout leur propre fortune.
Mais la nuit l'on s'adonne aux plaisirs de la chair.
Les deux champs
lexicaux qui animent cet extrait, l'argent et le sexe, sont si riches que Zola ne laisse aucune place à d'autres mobiles
des actions humaines dans cette société.
Outre la variété des termes dénotant le goût effréné de l'argent (« or », «
millions », « milliard ») et du sexe (« brutalité du désir », « contentement immédiat de l'instinct », « grand râle d'amour
»), il faut noter les procédés d'insistance - la triple répétition de « fortune », la double répétition de « amour », l'emploi
de mots de la même famille (« or » et « doré », « bras » et « embrassade ») - et de généralisation : la préférence
donnée systématiquement au pluriel qui estompe les individualités (« les appétits », « les divans », « les fiacres », les «
fenêtres »), la partie plutôt que le tout (les femmes sont réduites à des corsages, des chevelures, des dentelles, sans
qu'on montre leur visage).
Zola indique ainsi que la même fièvre s'empare de tous les aventuriers de Paris.
Cette omniprésence de la chair et de l'or est condensée, à la fin de l'extrait, dans le coffre-fort : le meuble qui
contient ^argent et les objets de valeur est décrit comme le lieu de la volupté, « une alcôve de fer ».
Zola file la
métaphore de l'alcôve en renforçant le parallèle par des précisions sur l'emplacement (« enfoncé dans le mur ») et les
dimensions (« grande à y coucher les amours d'un milliard ») et en prenant soin d'utiliser dans les deux cas une
expression qui s'applique aussi bien à un lit qu'à un coffre-fort.
Par cette trouvaille il unit indissolublement l'or et le
plaisir.
[II.
La satire d'une société]
Observateur attentif de son époque, Zola s'érige aussi en juge et même en satiriste, mais il se montre surtout un
visionnaire.
[1.
Zola observateur]
La vue de la profusion de richesses matérielles déployées sous le Second Empire inspire à Zola des parallèles
éclairants.
En associant par un zeugma au « bruit des quartiers écroulés » celui des « fortunes bâties en six mois », il
n'unit pas seulement le concret et l'abstrait, ou la démolition et la construction, il invite à penser que les fortunes
comme les immeubles sont susceptibles de s'écrouler aussi rapidement qu'elles ont été édifiées.
L'image récurrente du
feu au début du texte symbolise bien le caractère fulgurant, mais éphémère de cet enrichissement : « brûlait », « un
feu de joie colossal », « la curée ardente », « flamboiement des torches ».
Écrivant son roman une dizaine d'années à
peine après l'écroulement du Second Empire, Zola sait très bien que ce feu de joie n'a été, dans beaucoup de
domaines, qu'un feu de paille.
Le narrateur invite également à établir un parallèle entre la richesse de la capitale et la destinée d'un individu,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emile Zola, La Curée
- Le second Empire à travers l’œuvre d’Emile Zola « Au bonheur de Dames »
- Emile Zola, L'amour des bêtes
- Emile DESCHAMPS (1791-1871) - Aux mânes de Joseph Delorme
- L'oeuvre de Zola Emile