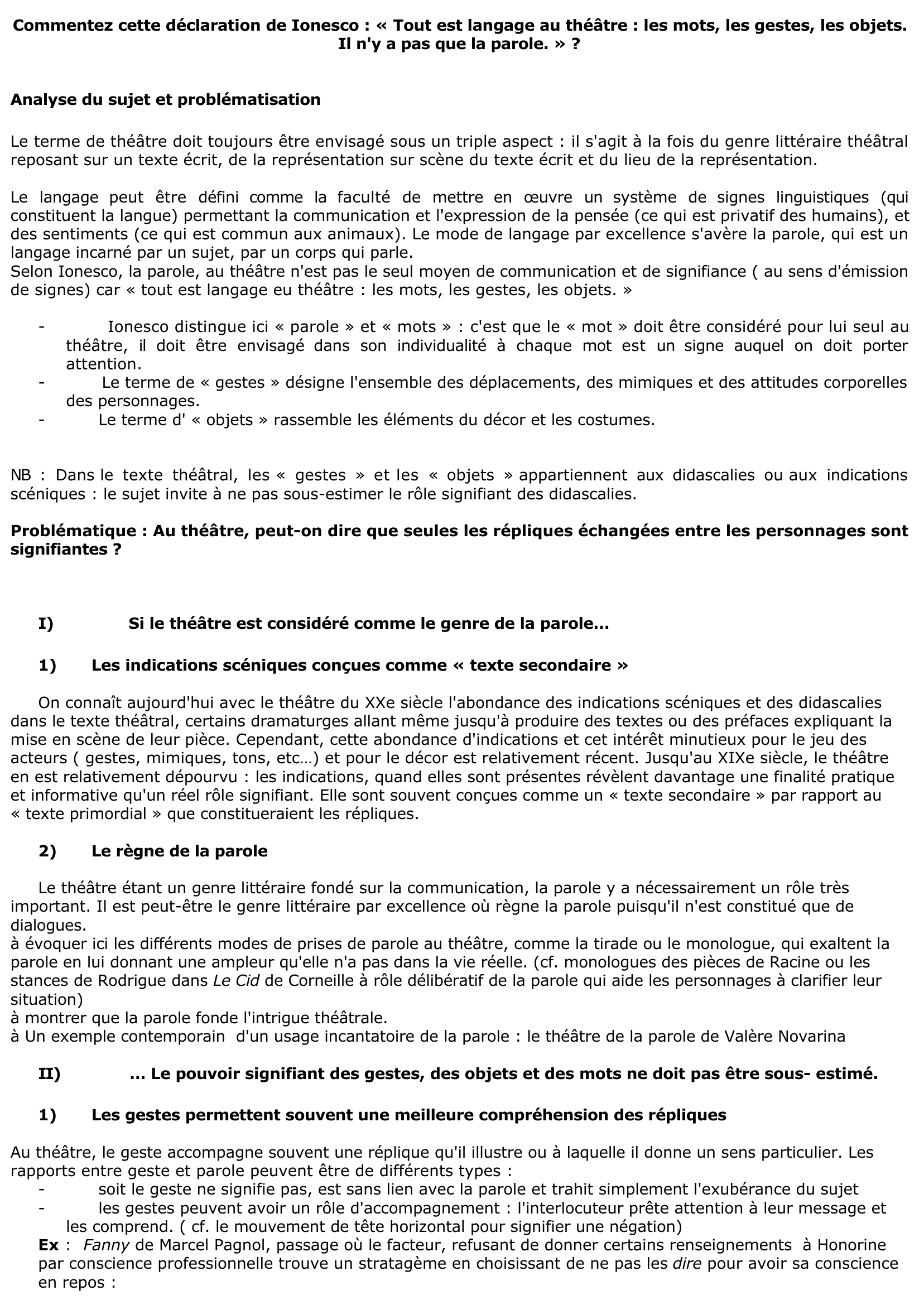Commentez cette déclaration de Ionesco : « Tout est langage au théâtre : les mots, les gestes, les objets. Il n'y a pas que la parole. » ?
Extrait du document
«
Commentez cette déclaration de Ionesco : « Tout est langage au théâtre : les mots, les gestes, les objets.
Il n'y a pas que la parole.
» ?
Analyse du sujet et problématisation
Le terme de théâtre doit toujours être envisagé sous un triple aspect : il s'agit à la fois du genre littéraire théâtral
reposant sur un texte écrit, de la représentation sur scène du texte écrit et du lieu de la représentation.
Le langage peut être défini comme la faculté de mettre en œuvre un système de signes linguistiques (qui
constituent la langue) permettant la communication et l'expression de la pensée (ce qui est privatif des humains), et
des sentiments (ce qui est commun aux animaux).
Le mode de langage par excellence s'avère la parole, qui est un
langage incarné par un sujet, par un corps qui parle.
Selon Ionesco, la parole, au théâtre n'est pas le seul moyen de communication et de signifiance ( au sens d'émission
de signes) car « tout est langage eu théâtre : les mots, les gestes, les objets.
»
-
-
Ionesco distingue ici « parole » et « mots » : c'est que le « mot » doit être considéré pour lui seul au
théâtre, il doit être envisagé dans son individualité à chaque mot est un signe auquel on doit porter
attention.
Le terme de « gestes » désigne l'ensemble des déplacements, des mimiques et des attitudes corporelles
des personnages.
Le terme d' « objets » rassemble les éléments du décor et les costumes.
NB : Dans le texte théâtral, les « gestes » et les « objets » appartiennent aux didascalies ou aux indications
scéniques : le sujet invite à ne pas sous-estimer le rôle signifiant des didascalies.
Problématique : Au théâtre, peut-on dire que seules les répliques échangées entre les personnages sont
signifiantes ?
I)
1)
Si le théâtre est considéré comme le genre de la parole…
Les indications scéniques conçues comme « texte secondaire »
On connaît aujourd'hui avec le théâtre du XXe siècle l'abondance des indications scéniques et des didascalies
dans le texte théâtral, certains dramaturges allant même jusqu'à produire des textes ou des préfaces expliquant la
mise en scène de leur pièce.
Cependant, cette abondance d'indications et cet intérêt minutieux pour le jeu des
acteurs ( gestes, mimiques, tons, etc…) et pour le décor est relativement récent.
Jusqu'au XIXe siècle, le théâtre
en est relativement dépourvu : les indications, quand elles sont présentes révèlent davantage une finalité pratique
et informative qu'un réel rôle signifiant.
Elle sont souvent conçues comme un « texte secondaire » par rapport au
« texte primordial » que constitueraient les répliques.
2)
Le règne de la parole
Le théâtre étant un genre littéraire fondé sur la communication, la parole y a nécessairement un rôle très
important.
Il est peut-être le genre littéraire par excellence où règne la parole puisqu'il n'est constitué que de
dialogues.
à évoquer ici les différents modes de prises de parole au théâtre, comme la tirade ou le monologue, qui exaltent la
parole en lui donnant une ampleur qu'elle n'a pas dans la vie réelle.
(cf.
monologues des pièces de Racine ou les
stances de Rodrigue dans Le Cid de Corneille à rôle délibératif de la parole qui aide les personnages à clarifier leur
situation)
à montrer que la parole fonde l'intrigue théâtrale.
à Un exemple contemporain d'un usage incantatoire de la parole : le théâtre de la parole de Valère Novarina
II)
1)
… Le pouvoir signifiant des gestes, des objets et des mots ne doit pas être sous- estimé.
Les gestes permettent souvent une meilleure compréhension des répliques
Au théâtre, le geste accompagne souvent une réplique qu'il illustre ou à laquelle il donne un sens particulier.
Les
rapports entre geste et parole peuvent être de différents types :
soit le geste ne signifie pas, est sans lien avec la parole et trahit simplement l'exubérance du sujet
les gestes peuvent avoir un rôle d'accompagnement : l'interlocuteur prête attention à leur message et
les comprend.
( cf.
le mouvement de tête horizontal pour signifier une négation)
Ex : Fanny de Marcel Pagnol, passage où le facteur, refusant de donner certains renseignements à Honorine
par conscience professionnelle trouve un stratagème en choisissant de ne pas les dire pour avoir sa conscience
en repos :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Au théâtre, il n'y a pas que le langage des mots. Après avoir exposé quelles différentes formes peut prendre ce langage, vous chercherez, en vous appuyant sur les textes du corpus et sur vos connaissances théâtrales, d'autres types de langages utilisés sur la scène. Vous expliquerez leur force et leur pouvoir symbolique.
- Parlant du monde romanesque et de ses personnages, Albert Camus écrit dans L'Homme révolté : les personnages ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est ni plus beau ni plus édifiant que le notre. Mais eux du moins,courent jusqu'au bout de leur destin et il n'est jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion. Commentez. Objets d'étude (extraits) : La Princesse de Clèves de La Fayette, Histoire du Chevalier Des Grieux et de
- « Le théâtre peut apparaître comme un genre littéraire inférieur, un genre mineur. Il fait toujours un peu gros. C'est un art à effets sans doutes. On a l'impression que les choses s'y alourdissent. Les nuances des textes de littérature l'éclipsent. Un théâtre de subtilité littéraire s'épuise vite. » Commentez cette citation de Ionesco.
- Commentez cette phrase de Ionesco : « Je ne fais pas de la littérature. Je fais quelque chose de tout à fait différent je fais du théâtre ».
- Dans son essai critique Sur Racine, Roland Barthes qualifie Bérénice de « tragédie de l'aphasie » ; Jean Starobinski, quant à lui, souligne « que dans le théâtre français classique, et singulièrement chez Racine, les gestes tendent à disparaître au profit du langage, il faut ajouter au profit du regard. Les scènes chez Racine sont des « entrevues ». Les personnes du drame se parlent et s'entre-regardent mais les regards échangés ont valeur d'étreinte et de blessure... Ils troublent les