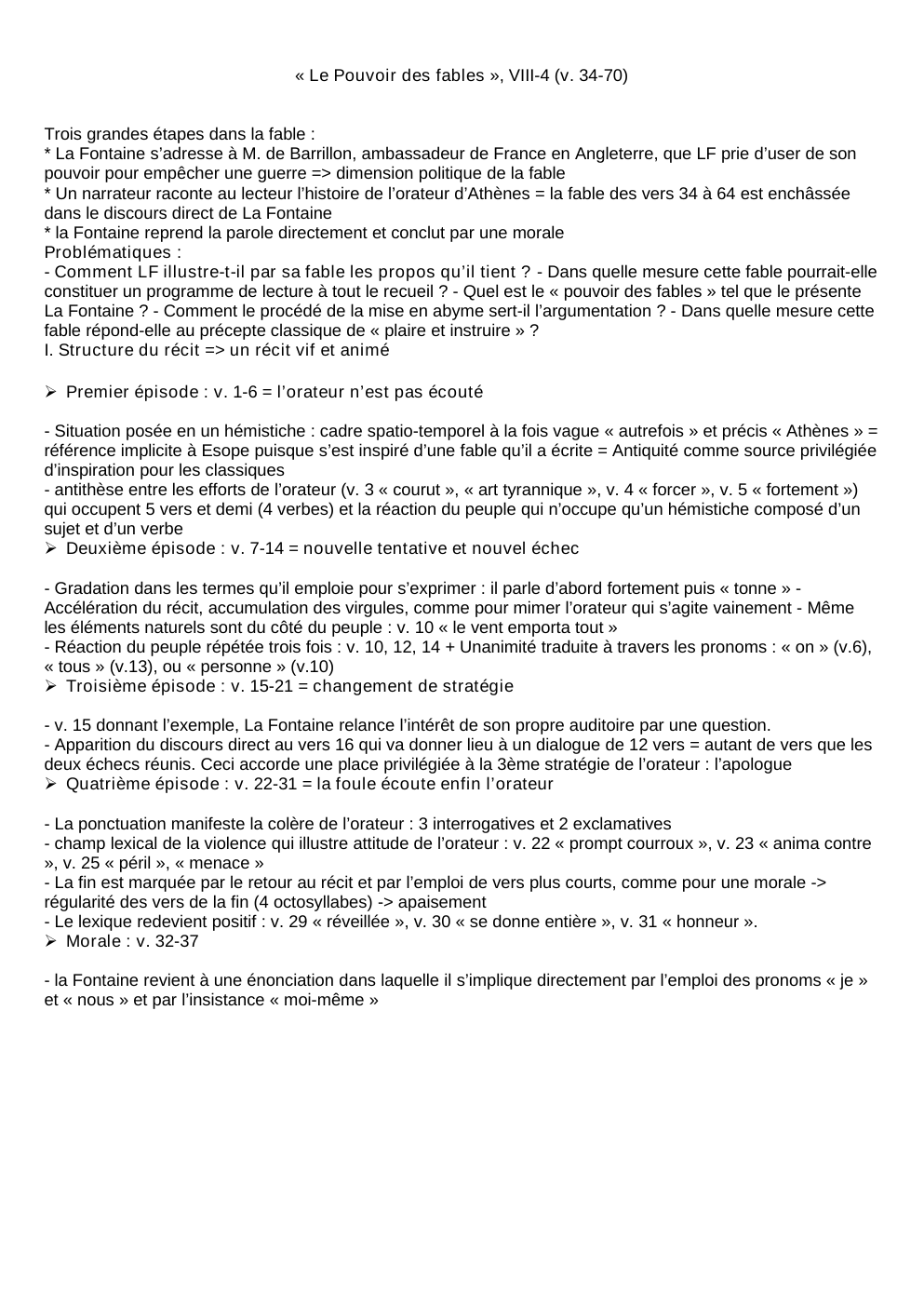Analyse "Le pouvoir des fables" - La Fontaine
Publié le 14/08/2025
Extrait du document
«
« Le Pouvoir des fables », VIII-4 (v.
34-70)
Trois grandes étapes dans la fable :
* La Fontaine s’adresse à M.
de Barrillon, ambassadeur de France en Angleterre, que LF prie d’user de son
pouvoir pour empêcher une guerre => dimension politique de la fable
* Un narrateur raconte au lecteur l’histoire de l’orateur d’Athènes = la fable des vers 34 à 64 est enchâssée
dans le discours direct de La Fontaine
* la Fontaine reprend la parole directement et conclut par une morale
Problématiques :
- Comment LF illustre-t-il par sa fable les propos qu’il tient ? - Dans quelle mesure cette fable pourrait-elle
constituer un programme de lecture à tout le recueil ? - Quel est le « pouvoir des fables » tel que le présente
La Fontaine ? - Comment le procédé de la mise en abyme sert-il l’argumentation ? - Dans quelle mesure cette
fable répond-elle au précepte classique de « plaire et instruire » ?
I.
Structure du récit => un récit vif et animé
Premier épisode : v.
1-6 = l’orateur n’est pas écouté
- Situation posée en un hémistiche : cadre spatio-temporel à la fois vague « autrefois » et précis « Athènes » =
référence implicite à Esope puisque s’est inspiré d’une fable qu’il a écrite = Antiquité comme source privilégiée
d’inspiration pour les classiques
- antithèse entre les efforts de l’orateur (v.
3 « courut », « art tyrannique », v.
4 « forcer », v.
5 « fortement »)
qui occupent 5 vers et demi (4 verbes) et la réaction du peuple qui n’occupe qu’un hémistiche composé d’un
sujet et d’un verbe
Deuxième épisode : v.
7-14 = nouvelle tentative et nouvel échec
- Gradation dans les termes qu’il emploie pour s’exprimer : il parle d’abord fortement puis « tonne » Accélération du récit, accumulation des virgules, comme pour mimer l’orateur qui s’agite vainement - Même
les éléments naturels sont du côté du peuple : v.
10 « le vent emporta tout »
- Réaction du peuple répétée trois fois : v.
10, 12, 14 + Unanimité traduite à travers les pronoms : « on » (v.6),
« tous » (v.13), ou « personne » (v.10)
Troisième épisode : v.
15-21 = changement de stratégie
- v.
15 donnant l’exemple, La Fontaine relance l’intérêt de son propre auditoire par une question.
- Apparition du discours direct au vers 16 qui va donner lieu à un dialogue de 12 vers = autant de vers que les
deux échecs réunis.
Ceci accorde une place privilégiée à la 3ème stratégie de l’orateur : l’apologue
Quatrième épisode : v.
22-31 = la foule écoute enfin l’orateur
- La ponctuation manifeste la colère de l’orateur : 3 interrogatives et 2 exclamatives
- champ lexical de la violence qui illustre attitude de l’orateur : v.
22 « prompt courroux », v.
23 « anima contre
», v.
25 « péril », « menace »
- La fin est marquée par le retour au récit et par l’emploi de vers plus courts, comme pour une morale ->
régularité des vers de la fin (4 octosyllabes) -> apaisement
- Le lexique redevient positif : v.
29 « réveillée », v.
30 « se donne entière », v.
31 « honneur ».
Morale : v.
32-37
- la Fontaine revient à une énonciation dans laquelle il s’implique directement par l’emploi des pronoms « je »
et « nous » et par l’insistance « moi-même »
II.
La dimension argumentative de ce récit
1.
L’échec de l’éloquence
- LF commence par mettre en scène ce qui ne fonctionne pas pour mieux mettre....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE LION, LE LOUP ET LE RENARD - LA FONTAINE in Fables
- Pontus de TYARD (1521-1605) (Recueil : Douze fables de fleuves) - Épigramme de la fontaine de Narcisse
- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Le Renard et la Cigogne
- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Les Deux Mulets
- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Le Lièvre et les Grenouilles