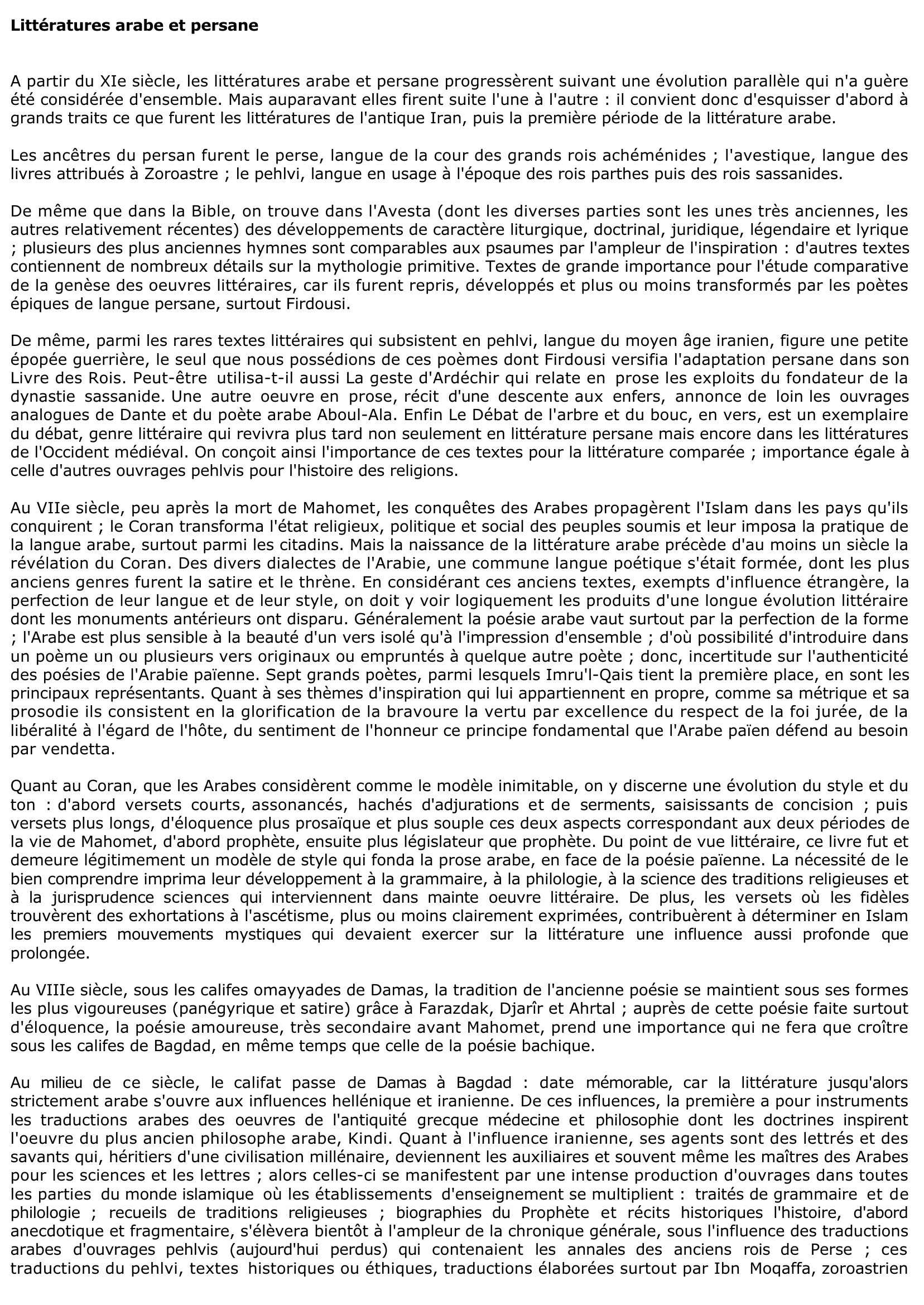Littératures arabe et persane
Extrait du document
«
Littératures arabe et persane
A partir du XIe siècle, les littératures arabe et persane progressèrent suivant une évolution parallèle qui n'a guère
été considérée d'ensemble.
Mais auparavant elles firent suite l'une à l'autre : il convient donc d'esquisser d'abord à
grands traits ce que furent les littératures de l'antique Iran, puis la première période de la littérature arabe.
Les ancêtres du persan furent le perse, langue de la cour des grands rois achéménides ; l'avestique, langue des
livres attribués à Zoroastre ; le pehlvi, langue en usage à l'époque des rois parthes puis des rois sassanides.
De même que dans la Bible, on trouve dans l'Avesta (dont les diverses parties sont les unes très anciennes, les
autres relativement récentes) des développements de caractère liturgique, doctrinal, juridique, légendaire et lyrique
; plusieurs des plus anciennes hymnes sont comparables aux psaumes par l'ampleur de l'inspiration : d'autres textes
contiennent de nombreux détails sur la mythologie primitive.
Textes de grande importance pour l'étude comparative
de la genèse des oeuvres littéraires, car ils furent repris, développés et plus ou moins transformés par les poètes
épiques de langue persane, surtout Firdousi.
De même, parmi les rares textes littéraires qui subsistent en pehlvi, langue du moyen âge iranien, figure une petite
épopée guerrière, le seul que nous possédions de ces poèmes dont Firdousi versifia l'adaptation persane dans son
Livre des Rois.
Peut-être utilisa-t-il aussi La geste d'Ardéchir qui relate en prose les exploits du fondateur de la
dynastie sassanide.
Une autre oeuvre en prose, récit d'une descente aux enfers, annonce de loin les ouvrages
analogues de Dante et du poète arabe Aboul-Ala.
Enfin Le Débat de l'arbre et du bouc, en vers, est un exemplaire
du débat, genre littéraire qui revivra plus tard non seulement en littérature persane mais encore dans les littératures
de l'Occident médiéval.
On conçoit ainsi l'importance de ces textes pour la littérature comparée ; importance égale à
celle d'autres ouvrages pehlvis pour l'histoire des religions.
Au VIIe siècle, peu après la mort de Mahomet, les conquêtes des Arabes propagèrent l'Islam dans les pays qu'ils
conquirent ; le Coran transforma l'état religieux, politique et social des peuples soumis et leur imposa la pratique de
la langue arabe, surtout parmi les citadins.
Mais la naissance de la littérature arabe précède d'au moins un siècle la
révélation du Coran.
Des divers dialectes de l'Arabie, une commune langue poétique s'était formée, dont les plus
anciens genres furent la satire et le thrène.
En considérant ces anciens textes, exempts d'influence étrangère, la
perfection de leur langue et de leur style, on doit y voir logiquement les produits d'une longue évolution littéraire
dont les monuments antérieurs ont disparu.
Généralement la poésie arabe vaut surtout par la perfection de la forme
; l'Arabe est plus sensible à la beauté d'un vers isolé qu'à l'impression d'ensemble ; d'où possibilité d'introduire dans
un poème un ou plusieurs vers originaux ou empruntés à quelque autre poète ; donc, incertitude sur l'authenticité
des poésies de l'Arabie païenne.
Sept grands poètes, parmi lesquels Imru'l-Qais tient la première place, en sont les
principaux représentants.
Quant à ses thèmes d'inspiration qui lui appartiennent en propre, comme sa métrique et sa
prosodie ils consistent en la glorification de la bravoure la vertu par excellence du respect de la foi jurée, de la
libéralité à l'égard de l'hôte, du sentiment de l'honneur ce principe fondamental que l'Arabe païen défend au besoin
par vendetta.
Quant au Coran, que les Arabes considèrent comme le modèle inimitable, on y discerne une évolution du style et du
ton : d'abord versets courts, assonancés, hachés d'adjurations et de serments, saisissants de concision ; puis
versets plus longs, d'éloquence plus prosaïque et plus souple ces deux aspects correspondant aux deux périodes de
la vie de Mahomet, d'abord prophète, ensuite plus législateur que prophète.
Du point de vue littéraire, ce livre fut et
demeure légitimement un modèle de style qui fonda la prose arabe, en face de la poésie païenne.
La nécessité de le
bien comprendre imprima leur développement à la grammaire, à la philologie, à la science des traditions religieuses et
à la jurisprudence sciences qui interviennent dans mainte oeuvre littéraire.
De plus, les versets où les fidèles
trouvèrent des exhortations à l'ascétisme, plus ou moins clairement exprimées, contribuèrent à déterminer en Islam
les premiers mouvements mystiques qui devaient exercer sur la littérature une influence aussi profonde que
prolongée.
Au VIIIe siècle, sous les califes omayyades de Damas, la tradition de l'ancienne poésie se maintient sous ses formes
les plus vigoureuses (panégyrique et satire) grâce à Farazdak, Djarîr et Ahrtal ; auprès de cette poésie faite surtout
d'éloquence, la poésie amoureuse, très secondaire avant Mahomet, prend une importance qui ne fera que croître
sous les califes de Bagdad, en même temps que celle de la poésie bachique.
Au milieu de ce siècle, le califat passe de Damas à Bagdad : date mémorable, car la littérature jusqu'alors
strictement arabe s'ouvre aux influences hellénique et iranienne.
De ces influences, la première a pour instruments
les traductions arabes des oeuvres de l'antiquité grecque médecine et philosophie dont les doctrines inspirent
l'oeuvre du plus ancien philosophe arabe, Kindi.
Quant à l'influence iranienne, ses agents sont des lettrés et des
savants qui, héritiers d'une civilisation millénaire, deviennent les auxiliaires et souvent même les maîtres des Arabes
pour les sciences et les lettres ; alors celles-ci se manifestent par une intense production d'ouvrages dans toutes
les parties du monde islamique où les établissements d'enseignement se multiplient : traités de grammaire et de
philologie ; recueils de traditions religieuses ; biographies du Prophète et récits historiques l'histoire, d'abord
anecdotique et fragmentaire, s'élèvera bientôt à l'ampleur de la chronique générale, sous l'influence des traductions
arabes d'ouvrages pehlvis (aujourd'hui perdus) qui contenaient les annales des anciens rois de Perse ; ces
traductions du pehlvi, textes historiques ou éthiques, traductions élaborées surtout par Ibn Moqaffa, zoroastrien.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor HUGO (1802-1885) (Recueil : Les orientales) - Adieux de l'hôtesse arabe
- Les littératures d'Europe centrale au XXe siècle
- Les littératures contemporaines francophones
- Les littératures nordiques du XXe siècle
- Naissance des littératures nationales