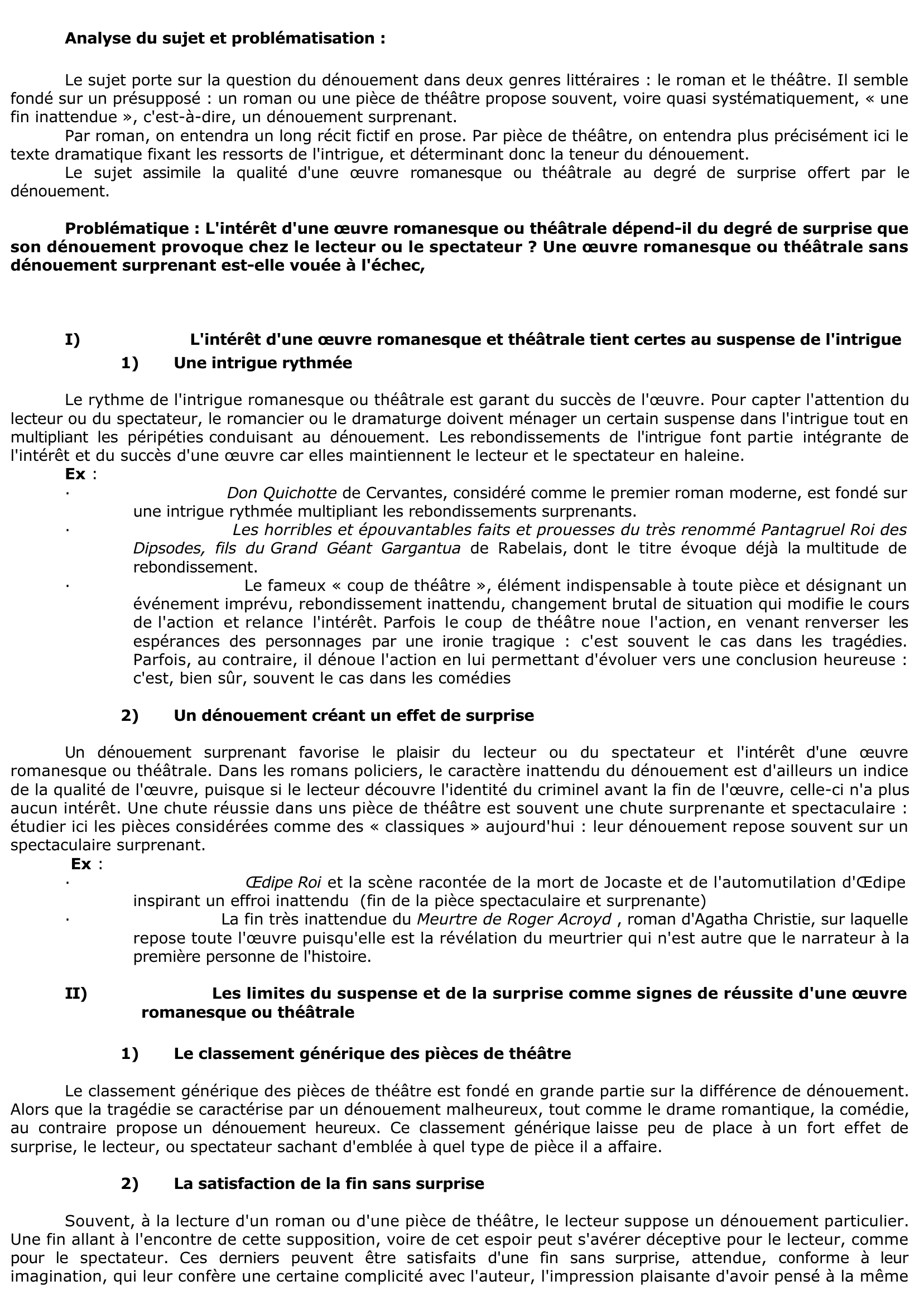Faut-il forcément une fin inatendue pour faire un roman ou une piéce de théatre réussie ?
Extrait du document
«
Analyse du sujet et problématisation :
Le sujet porte sur la question du dénouement dans deux genres littéraires : le roman et le théâtre.
Il semble
fondé sur un présupposé : un roman ou une pièce de théâtre propose souvent, voire quasi systématiquement, « une
fin inattendue », c'est-à-dire, un dénouement surprenant.
Par roman, on entendra un long récit fictif en prose.
Par pièce de théâtre, on entendra plus précisément ici le
texte dramatique fixant les ressorts de l'intrigue, et déterminant donc la teneur du dénouement.
Le sujet assimile la qualité d'une œuvre romanesque ou théâtrale au degré de surprise offert par le
dénouement.
Problématique : L'intérêt d'une œuvre romanesque ou théâtrale dépend-il du degré de surprise que
son dénouement provoque chez le lecteur ou le spectateur ? Une œuvre romanesque ou théâtrale sans
dénouement surprenant est-elle vouée à l'échec,
I)
L'intérêt d'une œuvre romanesque et théâtrale tient certes au suspense de l'intrigue
1)
Une intrigue rythmée
Le rythme de l'intrigue romanesque ou théâtrale est garant du succès de l'œuvre.
Pour capter l'attention du
lecteur ou du spectateur, le romancier ou le dramaturge doivent ménager un certain suspense dans l'intrigue tout en
multipliant les péripéties conduisant au dénouement.
Les rebondissements de l'intrigue font partie intégrante de
l'intérêt et du succès d'une œuvre car elles maintiennent le lecteur et le spectateur en haleine.
Ex :
·
Don Quichotte de Cervantes, considéré comme le premier roman moderne, est fondé sur
une intrigue rythmée multipliant les rebondissements surprenants.
·
Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des
Dipsodes, fils du Grand Géant Gargantua de Rabelais, dont le titre évoque déjà la multitude de
rebondissement.
·
Le fameux « coup de théâtre », élément indispensable à toute pièce et désignant un
événement imprévu, rebondissement inattendu, changement brutal de situation qui modifie le cours
de l'action et relance l'intérêt.
Parfois le coup de théâtre noue l'action, en venant renverser les
espérances des personnages par une ironie tragique : c'est souvent le cas dans les tragédies.
Parfois, au contraire, il dénoue l'action en lui permettant d'évoluer vers une conclusion heureuse :
c'est, bien sûr, souvent le cas dans les comédies
2)
Un dénouement créant un effet de surprise
Un dénouement surprenant favorise le plaisir du lecteur ou du spectateur et l'intérêt d'une œuvre
romanesque ou théâtrale.
Dans les romans policiers, le caractère inattendu du dénouement est d'ailleurs un indice
de la qualité de l'œuvre, puisque si le lecteur découvre l'identité du criminel avant la fin de l'œuvre, celle-ci n'a plus
aucun intérêt.
Une chute réussie dans uns pièce de théâtre est souvent une chute surprenante et spectaculaire :
étudier ici les pièces considérées comme des « classiques » aujourd'hui : leur dénouement repose souvent sur un
spectaculaire surprenant.
Ex :
·
Œdipe Roi et la scène racontée de la mort de Jocaste et de l'automutilation d'Œdipe
inspirant un effroi inattendu (fin de la pièce spectaculaire et surprenante)
·
La fin très inattendue du Meurtre de Roger Acroyd , roman d'Agatha Christie, sur laquelle
repose toute l'œuvre puisqu'elle est la révélation du meurtrier qui n'est autre que le narrateur à la
première personne de l'histoire.
II)
Les limites du suspense et de la surprise comme signes de réussite d'une œuvre
romanesque ou théâtrale
1)
Le classement générique des pièces de théâtre
Le classement générique des pièces de théâtre est fondé en grande partie sur la différence de dénouement.
Alors que la tragédie se caractérise par un dénouement malheureux, tout comme le drame romantique, la comédie,
au contraire propose un dénouement heureux.
Ce classement générique laisse peu de place à un fort effet de
surprise, le lecteur, ou spectateur sachant d'emblée à quel type de pièce il a affaire.
2)
La satisfaction de la fin sans surprise
Souvent, à la lecture d'un roman ou d'une pièce de théâtre, le lecteur suppose un dénouement particulier.
Une fin allant à l'encontre de cette supposition, voire de cet espoir peut s'avérer déceptive pour le lecteur, comme
pour le spectateur.
Ces derniers peuvent être satisfaits d'une fin sans surprise, attendue, conforme à leur
imagination, qui leur confère une certaine complicité avec l'auteur, l'impression plaisante d'avoir pensé à la même.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans ses Réflexions sur le roman, publiées en 1938, le critique Albert Thibaudet distingue les «lecteurs» qui « ne demandent au roman qu'une distraction, un rafraîchissement, un repos de la vie courante» et les «liseurs» pour qui le roman existe « non comme un divertissement accidentel, mais comme une fin essentielle». En vous fondant sur votre expérience personnelle et en vous aidant d'exemples précis, vous direz ce que vous pensez d'une telle distinction.
- Un bon roman fait-il forcément un bon film ?
- Edmond DE GONCOURT écrit, dans la préface des Frères Zemganno (1879) : Le réalisme, pour user du mot bête, du mot-drapeau, n'a pas l'unique mission de décrire ce qui est bas, ce qui est répugnant, ce qui pue. Il est venu au monde aussi, lui, pour définir dans de « l'écriture artiste » ce qui est élevé, ce qui est joli, ce qui sent bon, et encore pour donner les aspects et les profils des êtres raffinés et des choses riches : mais cela en vue d'une étude appliquée, rigoureuse et non con
- Commentez cette réflexion de P.-A. Touchard dans L'Amateur de théâtre ou la Règle du jeu : « Il y a une fatalité dans le roman comme il y a une fatalité au théâtre, mais la fatalité du roman est dans le personnage, celle du théâtre dans la situation. Le roman tend à nous faire souvenir que l'homme est déterminé par ses propres passions; le théâtre à nous rappeler que son destin demeure le jouet des événements. »
- Une histoire intéressante suffit-elle à faire un bon roman ?