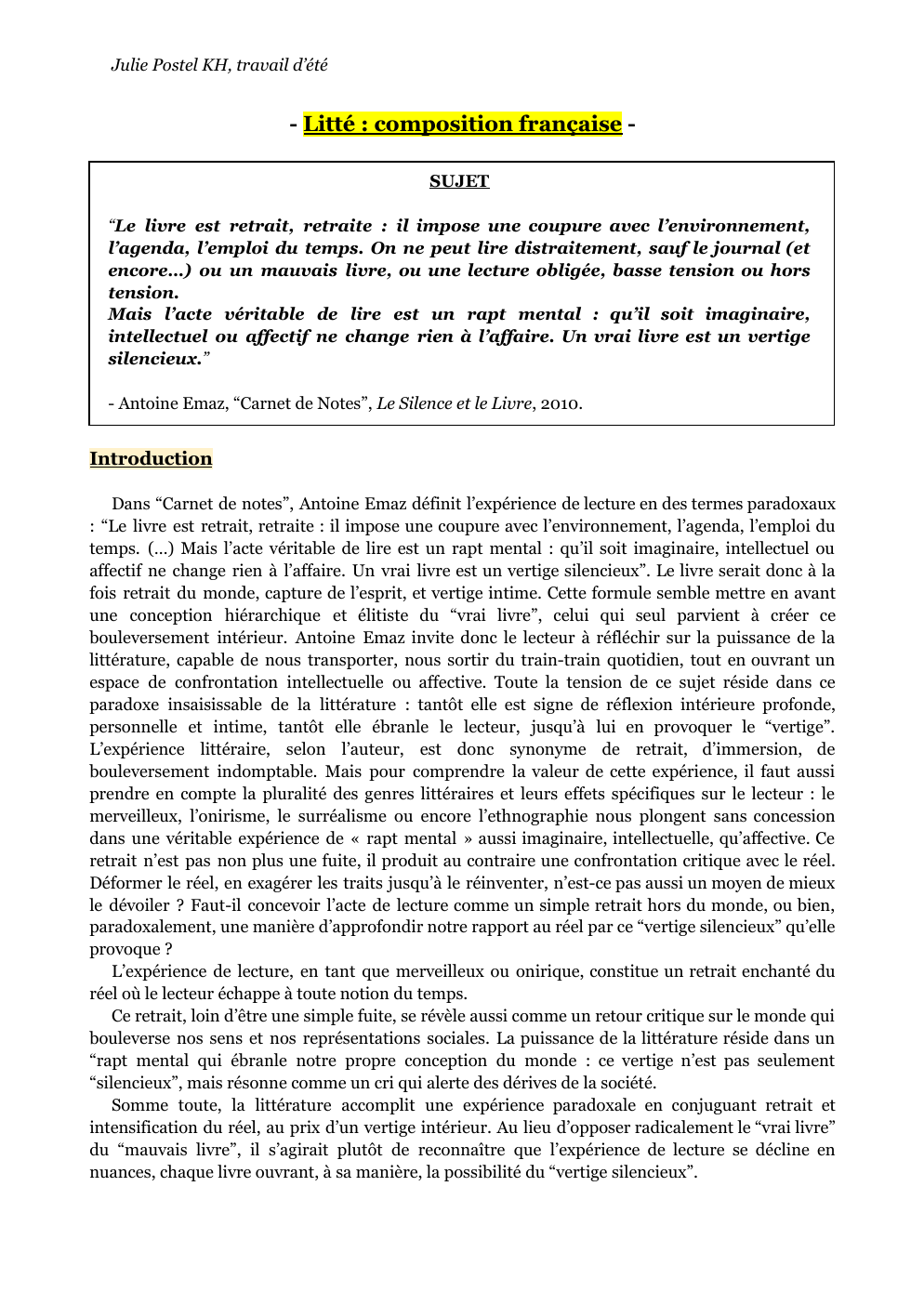Dissertation Antoine Emaz - Littérature khâgne - “Carnet de notes”, Antoine Emaz
Publié le 09/11/2025
Extrait du document
«
KH, travail d’été
- Litté : composition française SUJET
“Le livre est retrait, retraite : il impose une coupure avec l’environnement,
l’agenda, l’emploi du temps.
On ne peut lire distraitement, sauf le journal (et
encore…) ou un mauvais livre, ou une lecture obligée, basse tension ou hors
tension.
Mais l’acte véritable de lire est un rapt mental : qu’il soit imaginaire,
intellectuel ou affectif ne change rien à l’affaire.
Un vrai livre est un vertige
silencieux.”
- Antoine Emaz, “Carnet de Notes”, Le Silence et le Livre, 2010.
Introduction
Dans “Carnet de notes”, Antoine Emaz définit l’expérience de lecture en des termes paradoxaux
: “Le livre est retrait, retraite : il impose une coupure avec l’environnement, l’agenda, l’emploi du
temps.
(…) Mais l’acte véritable de lire est un rapt mental : qu’il soit imaginaire, intellectuel ou
affectif ne change rien à l’affaire.
Un vrai livre est un vertige silencieux”.
Le livre serait donc à la
fois retrait du monde, capture de l’esprit, et vertige intime.
Cette formule semble mettre en avant
une conception hiérarchique et élitiste du “vrai livre”, celui qui seul parvient à créer ce
bouleversement intérieur.
Antoine Emaz invite donc le lecteur à réfléchir sur la puissance de la
littérature, capable de nous transporter, nous sortir du train-train quotidien, tout en ouvrant un
espace de confrontation intellectuelle ou affective.
Toute la tension de ce sujet réside dans ce
paradoxe insaisissable de la littérature : tantôt elle est signe de réflexion intérieure profonde,
personnelle et intime, tantôt elle ébranle le lecteur, jusqu’à lui en provoquer le “vertige”.
L’expérience littéraire, selon l’auteur, est donc synonyme de retrait, d’immersion, de
bouleversement indomptable.
Mais pour comprendre la valeur de cette expérience, il faut aussi
prendre en compte la pluralité des genres littéraires et leurs effets spécifiques sur le lecteur : le
merveilleux, l’onirisme, le surréalisme ou encore l’ethnographie nous plongent sans concession
dans une véritable expérience de « rapt mental » aussi imaginaire, intellectuelle, qu’affective.
Ce
retrait n’est pas non plus une fuite, il produit au contraire une confrontation critique avec le réel.
Déformer le réel, en exagérer les traits jusqu’à le réinventer, n’est-ce pas aussi un moyen de mieux
le dévoiler ? Faut-il concevoir l’acte de lecture comme un simple retrait hors du monde, ou bien,
paradoxalement, une manière d’approfondir notre rapport au réel par ce “vertige silencieux” qu’elle
provoque ?
L’expérience de lecture, en tant que merveilleux ou onirique, constitue un retrait enchanté du
réel où le lecteur échappe à toute notion du temps.
Ce retrait, loin d’être une simple fuite, se révèle aussi comme un retour critique sur le monde qui
bouleverse nos sens et nos représentations sociales.
La puissance de la littérature réside dans un
“rapt mental qui ébranle notre propre conception du monde : ce vertige n’est pas seulement
“silencieux”, mais résonne comme un cri qui alerte des dérives de la société.
Somme toute, la littérature accomplit une expérience paradoxale en conjuguant retrait et
intensification du réel, au prix d’un vertige intérieur.
Au lieu d’opposer radicalement le “vrai livre”
du “mauvais livre”, il s’agirait plutôt de reconnaître que l’expérience de lecture se décline en
nuances, chaque livre ouvrant, à sa manière, la possibilité du “vertige silencieux”.
Julie Postel KH, travail d’été
I/ La lecture est un retrait enchanté, une immersion hors du réel, une
création d’un nouveau monde
A. Le merveilleux féerique comme rupture et immersion
Antoine Emaz évoque le “retrait” qu’impose un “vrai livre”, qui suspend “l’agenda” et
isole le lecteur dans une retraite.
Cette rupture radicale avec le quotidien suspend le réel
où le lecteur plonge dans un tout autre monde.
C’est bien ce qu’offrent les récits
merveilleux et oniriques : les contes sont le lieu où l’imagination a le pouvoir de tout
réinventer.
Ex : Les Contes de fées de Madame d’Aulnoy imposent notamment ce “retrait” du réel,
mais par l’imaginaire.
Dans L’Île de la Félicité, le prince Adolphe et la princesse Félicité
vivent dans un espace utopique hors du temps, protégé de la contrainte sociale.
Cet
univers coupe le lecteur de son quotidien et le plonge dans une atmosphère d’évasion.
Dans ce conte, le Prince Adolphe est lui aussi suspendu par le temps en ne pensant rester
dans le royaume que trois mois, alors qu’il s’agissait de trois cents ans.
Le merveilleux
fonctionne ici comme une invitation à quitter l’ordre rationnel : les métamorphoses, les
fées et les royaumes idéalisés suspendent le temps du quotidien.
Ce “vertige silencieux”
tient alors à la fascination d’un monde impossible mais désirable.
Par le merveilleux, le
lecteur accepte l’impossible et se laisse ravir par ce “rapt mental” imaginaire.
Réf : En effet, comme l’a pensé Tzvetan Todorov dans Introduction à la littérature
fantastique publié en 1970, le merveilleux permet au lecteur d’entrer sans résistance
dans l’irréel.
Todorov définit ainsi le merveilleux comme : “Dans le cas du merveilleux,
les lois de la nature sont abolies, et le lecteur accepte le nouveau monde tel quel”.
Par ces
mots, on comprend que cette acceptation sans résistance correspond bien au “rapt
mental” dont parle Antoine Emaz : le lecteur est ravi, captif d’un univers qui abolit le
réel.
De fait, le propre d’un conte est justement de suivre cette impression : le temps est
suspendu, le lieu souvent inconnu et la présence d’êtres imaginaires comme les fées, les
sorcières ou les lutins accentue ce décalage.
B. La lecture comme expérience d’éloignement du quotidien
Selon Antoine Emaz, “l’acte véritable de lire” ne peut être distrait, car il emporte le
lecteur dans un “rapt mental”, un état d’évasion totale qui suspend le monde extérieur.
L’expérience du récit de voyage est aussi affaire d'immersion : dès la Renaissance, le
lecteur y entreprend un éloignement absolu de son cadre familier.
Ex : Jean de Léry, dans son Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil publié en
1578, met en scène une rupture brutale avec “l’environnement” familier du lecteur
européen du XVIe siècle en l’emmenant dans un univers “autre”, soit celui des
Tupinambas.
“On croirait être transporté en un autre siècle et parmi un autre genre
d’hommes” écrit Jean de Léry au chapitre XVIII.
La rupture avec les repères culturels et
temporels du lecteur participe de facto à un “retrait” : lire, ici, c’est être déraciné,
déplacé, décentré.
L’expérience de vertige est totale dans le sens où la perception du
monde en est transformée, car il offre une autre vision encore méconnue de la réalité.
Ici,
l’éloignement n’est pas seulement spatial avec la découverte du Brésil, mais il est aussi
mental et symbolique : être “transporté en un autre siècle”, c’est entrer dans un espace
en décalage avec nos sens et nos repères.
Réf : Hans Robert Jauss théorise notamment cette impression dans son ouvrage Pour
une esthétique de la réception, publié en 1978 lorsqu’il écrit : “L’œuvre littéraire rompt
avec l’horizon d’attente de son lecteur, et c’est dans cette distance qu’elle produit
Julie Postel KH, travail d’été
l’expérience esthétique”.
La force de Jean de Léry réside justement dans ce décalage ainsi
décrit : le lecteur de la Renaissance, habitué aux récits antiques ou aux chroniques
européennes, est soudain confronté à des pratiques, des rituels et des paysages inouïs,
comme le cannibalisme des Tupinambas ou encore la description des fêtes indigènes.
Le
voyage ethnographique joue donc avec “l’écart esthétique” en bouleversant les attentes
du lecteur européen.
C. La plongée dans une intériorité hallucinée
Le livre est en somme le lieu d’un “retrait” non pas tranquille, mais d’un basculement de
la conscience.
C’est ce que met en scène Nerval dans Aurélia publié en 1855, qui explore
justement un tout autre “retrait” : celui du rêve et de la folie.
Ex n°1 : L’incipit proclame d’emblée : “Le rêve est une seconde vie” (p.123) qui incite le
lecteur à entrer dans une logique autre que celle de la raison, où le songe et les pensées
délirantes priment.
Le récit se structure comme une suite d’images hallucinées : “Je
traversais des palais immenses, illuminés de feux d’Orient”, écrit Nerval.
Le “vertige
silencieux” prend ici réellement corps, dans le sens ou lecture et rêve se confondent.
Le
livre n’est donc pas réduit à un simple objet de divertissement ou de “basse tension”,
mais il saisit le lecteur dans une absorption totale par les descriptions de rêves et de
visions quasi mystiques du narrateur.
En effet, à la fin du roman au chapitre six, après
plusieurs crises de folie, le narrateur est conduit dans une maison de santé dans laquelle
il ne perçoit plus la réalité telle qu’elle est : tout est transformé, dédoublé, distant.
Cette
expérience de lecture marque un choc mental intense aussi bien pour le narrateur que
pour le lecteur.
Ex n°2 : Chez Aragon dans son ouvrage Le Paysan de Paris publié en 1926, l’expérience
est comparable.
Les pages consacrées au “Passage de l’Opéra” décrivent la ville dans une
atmosphère onirique.“Le rêve est le luxe de la pensée” (p.
96), écrit ainsi Aragon pour
souligner le fait que l’immersion dans le texte poétique suspend le réel et aboutit à une
expérience intérieure....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La littérature doit donc être lue et étudiée, soutient Antoine Compagnon, parce qu'elle offre un moyen - certains diront même le seul - de préserver et de transmettre l'expérience des autres, ceux qui sont éloignés de nous dans l'espace et dans le temps ou qui diffèrent de nous par les conditions de leur vie. » (La littérature, pour quoi faire ? p. 63). Qu'en pensez-vous ?
- Dissertation "comment la guerre froide a-t-elle pris fin en Europe et dans le monde?"
- Carnet de lecteur Mémoires D'Hadrien
- Dissertation sur Gargantua: le sérieux et le comique
- Dissertation Théâtre: «J’ai pris sa mort pour vraie, et ce n’était que feinte»