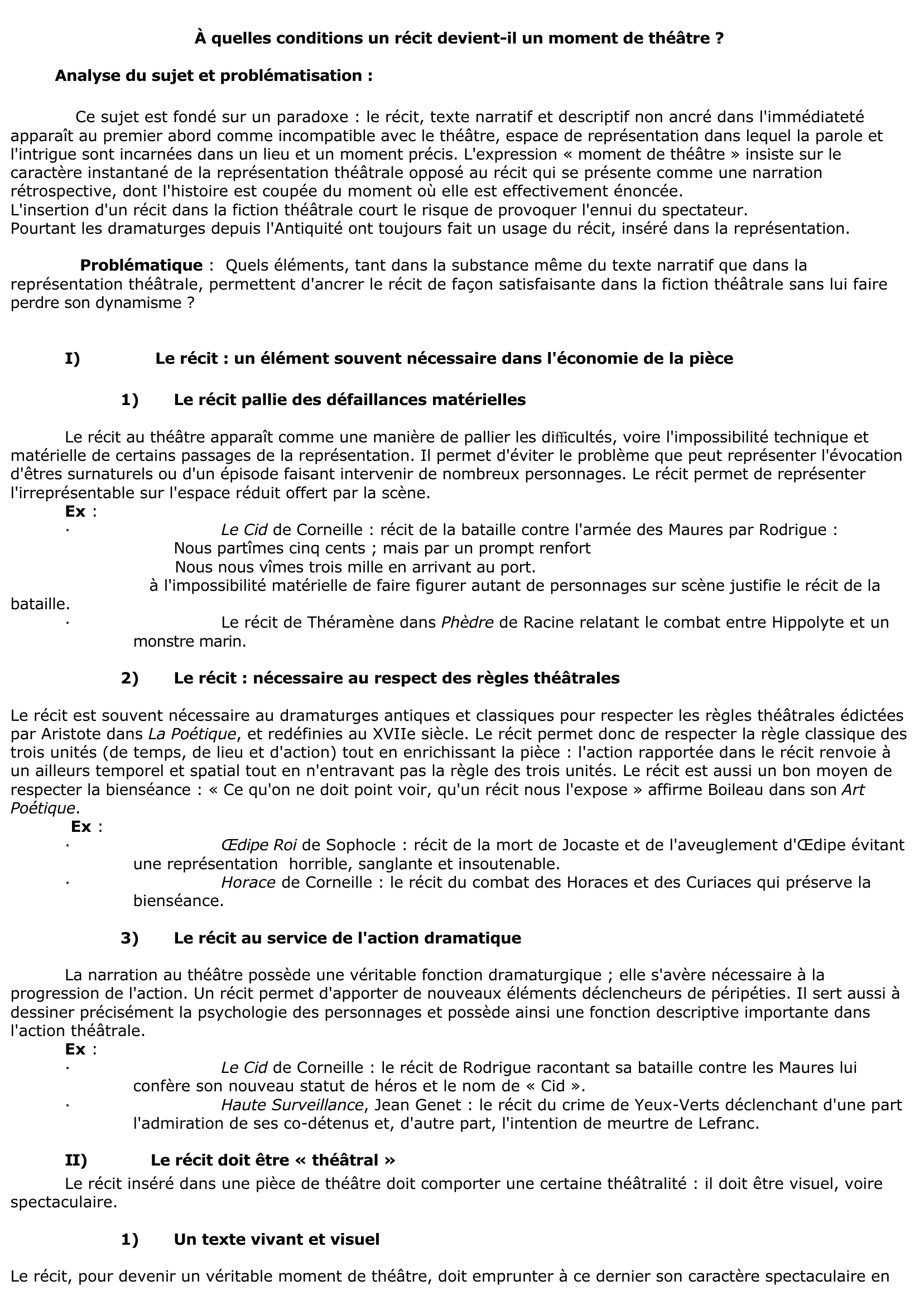À quelles conditions un récit devient-il un moment de théâtre ?
Extrait du document
«
À quelles conditions un récit devient-il un moment de théâtre ?
Analyse du sujet et problématisation :
Ce sujet est fondé sur un paradoxe : le récit, texte narratif et descriptif non ancré dans l'immédiateté
apparaît au premier abord comme incompatible avec le théâtre, espace de représentation dans lequel la parole et
l'intrigue sont incarnées dans un lieu et un moment précis.
L'expression « moment de théâtre » insiste sur le
caractère instantané de la représentation théâtrale opposé au récit qui se présente comme une narration
rétrospective, dont l'histoire est coupée du moment où elle est effectivement énoncée.
L'insertion d'un récit dans la fiction théâtrale court le risque de provoquer l'ennui du spectateur.
Pourtant les dramaturges depuis l'Antiquité ont toujours fait un usage du récit, inséré dans la représentation.
Problématique : Quels éléments, tant dans la substance même du texte narratif que dans la
représentation théâtrale, permettent d'ancrer le récit de façon satisfaisante dans la fiction théâtrale sans lui faire
perdre son dynamisme ?
I)
Le récit : un élément souvent nécessaire dans l'économie de la pièce
1)
Le récit pallie des défaillances matérielles
Le récit au théâtre apparaît comme une manière de pallier les difficultés, voire l'impossibilité technique et
matérielle de certains passages de la représentation.
Il permet d'éviter le problème que peut représenter l'évocation
d'êtres surnaturels ou d'un épisode faisant intervenir de nombreux personnages.
Le récit permet de représenter
l'irreprésentable sur l'espace réduit offert par la scène.
Ex :
·
Le Cid de Corneille : récit de la bataille contre l'armée des Maures par Rodrigue :
Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port.
à l'impossibilité matérielle de faire figurer autant de personnages sur scène justifie le récit de la
bataille.
·
Le récit de Théramène dans Phèdre de Racine relatant le combat entre Hippolyte et un
monstre marin.
2)
Le récit : nécessaire au respect des règles théâtrales
Le récit est souvent nécessaire au dramaturges antiques et classiques pour respecter les règles théâtrales édictées
par Aristote dans La Poétique, et redéfinies au XVIIe siècle.
Le récit permet donc de respecter la règle classique des
trois unités (de temps, de lieu et d'action) tout en enrichissant la pièce : l'action rapportée dans le récit renvoie à
un ailleurs temporel et spatial tout en n'entravant pas la règle des trois unités.
Le récit est aussi un bon moyen de
respecter la bienséance : « Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose » affirme Boileau dans son Art
Poétique.
Ex :
·
Œdipe Roi de Sophocle : récit de la mort de Jocaste et de l'aveuglement d'Œdipe évitant
une représentation horrible, sanglante et insoutenable.
·
Horace de Corneille : le récit du combat des Horaces et des Curiaces qui préserve la
bienséance.
3)
Le récit au service de l'action dramatique
La narration au théâtre possède une véritable fonction dramaturgique ; elle s'avère nécessaire à la
progression de l'action.
Un récit permet d'apporter de nouveaux éléments déclencheurs de péripéties.
Il sert aussi à
dessiner précisément la psychologie des personnages et possède ainsi une fonction descriptive importante dans
l'action théâtrale.
Ex :
·
Le Cid de Corneille : le récit de Rodrigue racontant sa bataille contre les Maures lui
confère son nouveau statut de héros et le nom de « Cid ».
·
Haute Surveillance, Jean Genet : le récit du crime de Yeux-Verts déclenchant d'une part
l'admiration de ses co-détenus et, d'autre part, l'intention de meurtre de Lefranc.
II)
Le récit doit être « théâtral »
Le récit inséré dans une pièce de théâtre doit comporter une certaine théâtralité : il doit être visuel, voire
spectaculaire.
1)
Un texte vivant et visuel
Le récit, pour devenir un véritable moment de théâtre, doit emprunter à ce dernier son caractère spectaculaire en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tout est permis au théâtre: incarner des personnages, mais aussi matérialiser des angoisses, des présences intérieures. Il est donc non seulement permis, mais recommandé, de faire jouer les accessoires, faire vivre les objets, animer les décors, concrétiser les symboles. De même que la parole est continuée par le geste, le jeu, la pantomime, qui, au moment où la parole devient insuffisante, se substituent à elle, les éléments scéniques matériels peuvent l'amplifier à leur tour. A la l
- « Ce que le théâtre peut montrer de plus émouvant est un caractère en train de se faire, le moment du choix, de la libre décision qui engage une morale et toute une vie. Et comme il n'y a de théâtre que si l'on réalise l'unité de tous les spectateurs, il faut trouver des situations si générales qu'elles soient communes à tous. » (J.-P. Sartre). Expliquez et commentez ces réflexions en vous appuyant sur les pièces de Jean-Paul Sartre que vous connaissez.
- Dans quelle mesure et à quelles conditions le théâtre est-il « une tribune », « une chaire » comme le veut Victor Hugo (cf. Préface de Lucrèce Borgia) ?
- Il faut imaginer la préface d'une pièce de théâtre ou l'auteur refuse de respecter les conditions du théâtre classique ?
- Ce que le théâtre peut montrer de plus émouvant est un caractère en train de se faire, le moment du choix, de la libre décision qui engage une morale et toute une vie. Et comme il n'y a de théâtre que si l'on réalise l'unité de tous les spectateurs, il faut trouver des situations si générales qu'elles soient communesà tous. Expliquez et commentez ces réflexions en vous appuyant sur les pièces de Sartre que vous connaissez ?