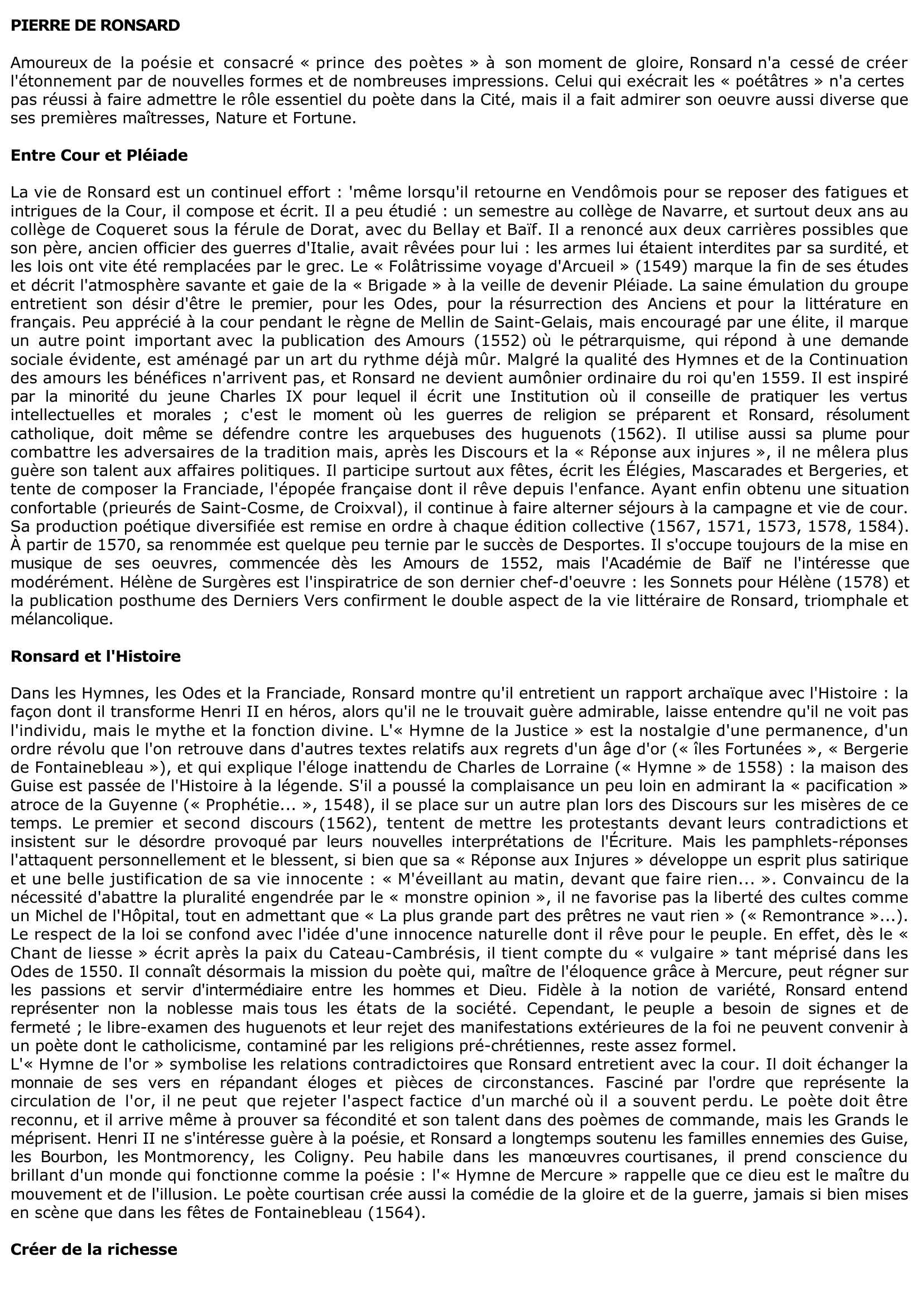PIERRE DE RONSARD
Extrait du document
«
PIERRE DE RONSARD
Amoureux de la poésie et consacré « prince des poètes » à son moment de gloire, Ronsard n'a cessé de créer
l'étonnement par de nouvelles formes et de nombreuses impressions.
Celui qui exécrait les « poétâtres » n'a certes
pas réussi à faire admettre le rôle essentiel du poète dans la Cité, mais il a fait admirer son oeuvre aussi diverse que
ses premières maîtresses, Nature et Fortune.
Entre Cour et Pléiade
La vie de Ronsard est un continuel effort : 'même lorsqu'il retourne en Vendômois pour se reposer des fatigues et
intrigues de la Cour, il compose et écrit.
Il a peu étudié : un semestre au collège de Navarre, et surtout deux ans au
collège de Coqueret sous la férule de Dorat, avec du Bellay et Baïf.
Il a renoncé aux deux carrières possibles que
son père, ancien officier des guerres d'Italie, avait rêvées pour lui : les armes lui étaient interdites par sa surdité, et
les lois ont vite été remplacées par le grec.
Le « Folâtrissime voyage d'Arcueil » (1549) marque la fin de ses études
et décrit l'atmosphère savante et gaie de la « Brigade » à la veille de devenir Pléiade.
La saine émulation du groupe
entretient son désir d'être le premier, pour les Odes, pour la résurrection des Anciens et pour la littérature en
français.
Peu apprécié à la cour pendant le règne de Mellin de Saint-Gelais, mais encouragé par une élite, il marque
un autre point important avec la publication des Amours (1552) où le pétrarquisme, qui répond à une demande
sociale évidente, est aménagé par un art du rythme déjà mûr.
Malgré la qualité des Hymnes et de la Continuation
des amours les bénéfices n'arrivent pas, et Ronsard ne devient aumônier ordinaire du roi qu'en 1559.
Il est inspiré
par la minorité du jeune Charles IX pour lequel il écrit une Institution où il conseille de pratiquer les vertus
intellectuelles et morales ; c'est le moment où les guerres de religion se préparent et Ronsard, résolument
catholique, doit même se défendre contre les arquebuses des huguenots (1562).
Il utilise aussi sa plume pour
combattre les adversaires de la tradition mais, après les Discours et la « Réponse aux injures », il ne mêlera plus
guère son talent aux affaires politiques.
Il participe surtout aux fêtes, écrit les Élégies, Mascarades et Bergeries, et
tente de composer la Franciade, l'épopée française dont il rêve depuis l'enfance.
Ayant enfin obtenu une situation
confortable (prieurés de Saint-Cosme, de Croixval), il continue à faire alterner séjours à la campagne et vie de cour.
Sa production poétique diversifiée est remise en ordre à chaque édition collective (1567, 1571, 1573, 1578, 1584).
À partir de 1570, sa renommée est quelque peu ternie par le succès de Desportes.
Il s'occupe toujours de la mise en
musique de ses oeuvres, commencée dès les Amours de 1552, mais l'Académie de Baïf ne l'intéresse que
modérément.
Hélène de Surgères est l'inspiratrice de son dernier chef-d'oeuvre : les Sonnets pour Hélène (1578) et
la publication posthume des Derniers Vers confirment le double aspect de la vie littéraire de Ronsard, triomphale et
mélancolique.
Ronsard et l'Histoire
Dans les Hymnes, les Odes et la Franciade, Ronsard montre qu'il entretient un rapport archaïque avec l'Histoire : la
façon dont il transforme Henri II en héros, alors qu'il ne le trouvait guère admirable, laisse entendre qu'il ne voit pas
l'individu, mais le mythe et la fonction divine.
L'« Hymne de la Justice » est la nostalgie d'une permanence, d'un
ordre révolu que l'on retrouve dans d'autres textes relatifs aux regrets d'un âge d'or (« îles Fortunées », « Bergerie
de Fontainebleau »), et qui explique l'éloge inattendu de Charles de Lorraine (« Hymne » de 1558) : la maison des
Guise est passée de l'Histoire à la légende.
S'il a poussé la complaisance un peu loin en admirant la « pacification »
atroce de la Guyenne (« Prophétie...
», 1548), il se place sur un autre plan lors des Discours sur les misères de ce
temps.
Le premier et second discours (1562), tentent de mettre les protestants devant leurs contradictions et
insistent sur le désordre provoqué par leurs nouvelles interprétations de l'Écriture.
Mais les pamphlets-réponses
l'attaquent personnellement et le blessent, si bien que sa « Réponse aux Injures » développe un esprit plus satirique
et une belle justification de sa vie innocente : « M'éveillant au matin, devant que faire rien...
».
Convaincu de la
nécessité d'abattre la pluralité engendrée par le « monstre opinion », il ne favorise pas la liberté des cultes comme
un Michel de l'Hôpital, tout en admettant que « La plus grande part des prêtres ne vaut rien » (« Remontrance »...).
Le respect de la loi se confond avec l'idée d'une innocence naturelle dont il rêve pour le peuple.
En effet, dès le «
Chant de liesse » écrit après la paix du Cateau-Cambrésis, il tient compte du « vulgaire » tant méprisé dans les
Odes de 1550.
Il connaît désormais la mission du poète qui, maître de l'éloquence grâce à Mercure, peut régner sur
les passions et servir d'intermédiaire entre les hommes et Dieu.
Fidèle à la notion de variété, Ronsard entend
représenter non la noblesse mais tous les états de la société.
Cependant, le peuple a besoin de signes et de
fermeté ; le libre-examen des huguenots et leur rejet des manifestations extérieures de la foi ne peuvent convenir à
un poète dont le catholicisme, contaminé par les religions pré-chrétiennes, reste assez formel.
L'« Hymne de l'or » symbolise les relations contradictoires que Ronsard entretient avec la cour.
Il doit échanger la
monnaie de ses vers en répandant éloges et pièces de circonstances.
Fasciné par l'ordre que représente la
circulation de l'or, il ne peut que rejeter l'aspect factice d'un marché où il a souvent perdu.
Le poète doit être
reconnu, et il arrive même à prouver sa fécondité et son talent dans des poèmes de commande, mais les Grands le
méprisent.
Henri II ne s'intéresse guère à la poésie, et Ronsard a longtemps soutenu les familles ennemies des Guise,
les Bourbon, les Montmorency, les Coligny.
Peu habile dans les manœuvres courtisanes, il prend conscience du
brillant d'un monde qui fonctionne comme la poésie : l'« Hymne de Mercure » rappelle que ce dieu est le maître du
mouvement et de l'illusion.
Le poète courtisan crée aussi la comédie de la gloire et de la guerre, jamais si bien mises
en scène que dans les fêtes de Fontainebleau (1564).
Créer de la richesse.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Puisqu'elle est Tout Hiver. Pierre RONSARD: Sonnets pour Hélène
- Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Les Odes) - Quand je suis vingt ou trente mois
- Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Derniers vers) - Stances
- Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Les meslanges) - Ode à la fièvre
- Pierre de RONSARD (1524-1585) (Recueil : Premier livre des Amours) - Petit nombril, que mon penser adore