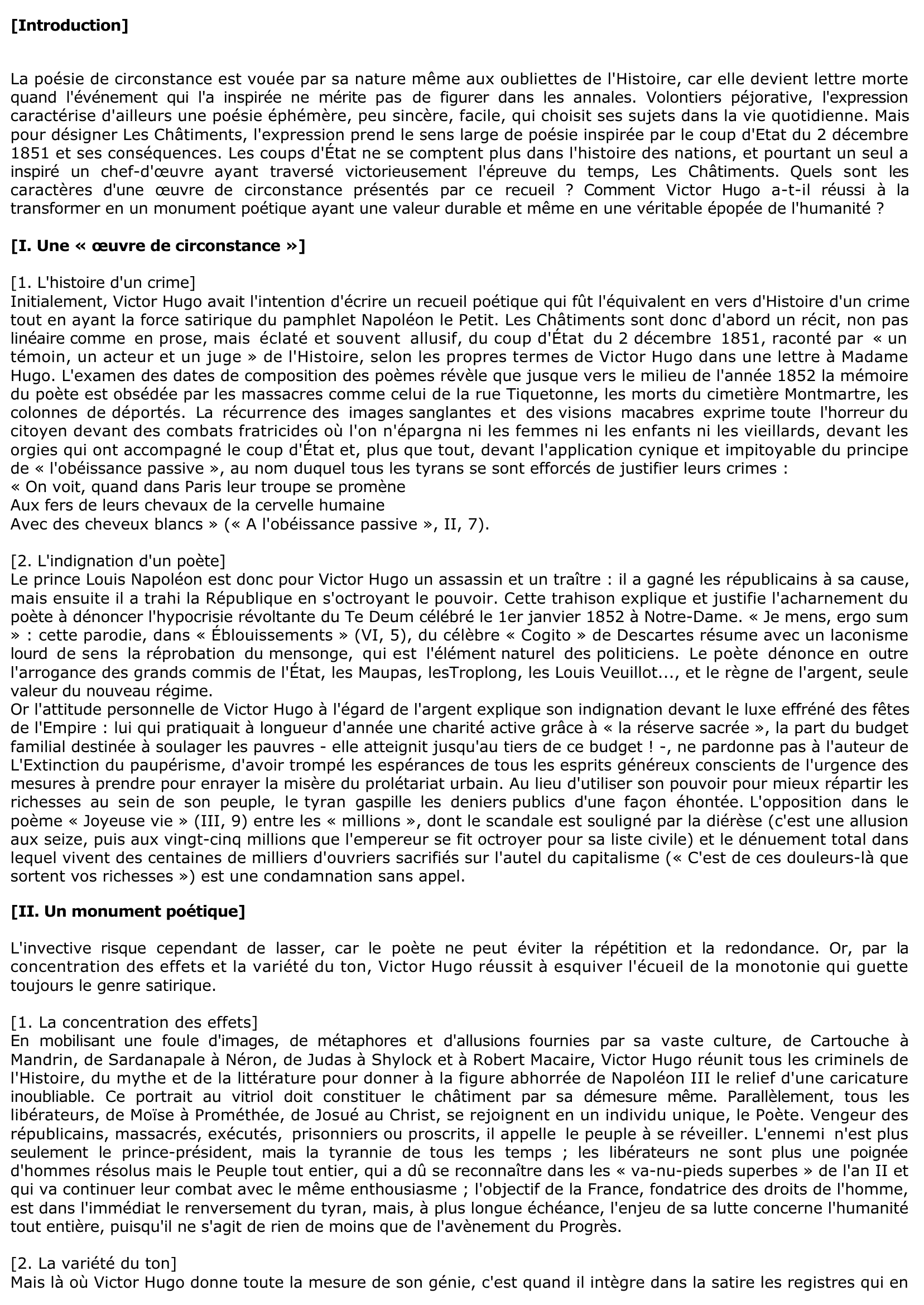Comment expliquez-vous que, d'« oeuvre de circonstance », Les Châtiments aient fini par devenir un monument poétique ayant survécu à son temps ?
Extrait du document
«
[Introduction]
La poésie de circonstance est vouée par sa nature même aux oubliettes de l'Histoire, car elle devient lettre morte
quand l'événement qui l'a inspirée ne mérite pas de figurer dans les annales.
Volontiers péjorative, l'expression
caractérise d'ailleurs une poésie éphémère, peu sincère, facile, qui choisit ses sujets dans la vie quotidienne.
Mais
pour désigner Les Châtiments, l'expression prend le sens large de poésie inspirée par le coup d'Etat du 2 décembre
1851 et ses conséquences.
Les coups d'État ne se comptent plus dans l'histoire des nations, et pourtant un seul a
inspiré un chef-d'œuvre ayant traversé victorieusement l'épreuve du temps, Les Châtiments.
Quels sont les
caractères d'une œuvre de circonstance présentés par ce recueil ? Comment Victor Hugo a-t-il réussi à la
transformer en un monument poétique ayant une valeur durable et même en une véritable épopée de l'humanité ?
[I.
Une « œuvre de circonstance »]
[1.
L'histoire d'un crime]
Initialement, Victor Hugo avait l'intention d'écrire un recueil poétique qui fût l'équivalent en vers d'Histoire d'un crime
tout en ayant la force satirique du pamphlet Napoléon le Petit.
Les Châtiments sont donc d'abord un récit, non pas
linéaire comme en prose, mais éclaté et souvent allusif, du coup d'État du 2 décembre 1851, raconté par « un
témoin, un acteur et un juge » de l'Histoire, selon les propres termes de Victor Hugo dans une lettre à Madame
Hugo.
L'examen des dates de composition des poèmes révèle que jusque vers le milieu de l'année 1852 la mémoire
du poète est obsédée par les massacres comme celui de la rue Tiquetonne, les morts du cimetière Montmartre, les
colonnes de déportés.
La récurrence des images sanglantes et des visions macabres exprime toute l'horreur du
citoyen devant des combats fratricides où l'on n'épargna ni les femmes ni les enfants ni les vieillards, devant les
orgies qui ont accompagné le coup d'État et, plus que tout, devant l'application cynique et impitoyable du principe
de « l'obéissance passive », au nom duquel tous les tyrans se sont efforcés de justifier leurs crimes :
« On voit, quand dans Paris leur troupe se promène
Aux fers de leurs chevaux de la cervelle humaine
Avec des cheveux blancs » (« A l'obéissance passive », II, 7).
[2.
L'indignation d'un poète]
Le prince Louis Napoléon est donc pour Victor Hugo un assassin et un traître : il a gagné les républicains à sa cause,
mais ensuite il a trahi la République en s'octroyant le pouvoir.
Cette trahison explique et justifie l'acharnement du
poète à dénoncer l'hypocrisie révoltante du Te Deum célébré le 1er janvier 1852 à Notre-Dame.
« Je mens, ergo sum
» : cette parodie, dans « Éblouissements » (VI, 5), du célèbre « Cogito » de Descartes résume avec un laconisme
lourd de sens la réprobation du mensonge, qui est l'élément naturel des politiciens.
Le poète dénonce en outre
l'arrogance des grands commis de l'État, les Maupas, lesTroplong, les Louis Veuillot..., et le règne de l'argent, seule
valeur du nouveau régime.
Or l'attitude personnelle de Victor Hugo à l'égard de l'argent explique son indignation devant le luxe effréné des fêtes
de l'Empire : lui qui pratiquait à longueur d'année une charité active grâce à « la réserve sacrée », la part du budget
familial destinée à soulager les pauvres - elle atteignit jusqu'au tiers de ce budget ! -, ne pardonne pas à l'auteur de
L'Extinction du paupérisme, d'avoir trompé les espérances de tous les esprits généreux conscients de l'urgence des
mesures à prendre pour enrayer la misère du prolétariat urbain.
Au lieu d'utiliser son pouvoir pour mieux répartir les
richesses au sein de son peuple, le tyran gaspille les deniers publics d'une façon éhontée.
L'opposition dans le
poème « Joyeuse vie » (III, 9) entre les « millions », dont le scandale est souligné par la diérèse (c'est une allusion
aux seize, puis aux vingt-cinq millions que l'empereur se fit octroyer pour sa liste civile) et le dénuement total dans
lequel vivent des centaines de milliers d'ouvriers sacrifiés sur l'autel du capitalisme (« C'est de ces douleurs-là que
sortent vos richesses ») est une condamnation sans appel.
[II.
Un monument poétique]
L'invective risque cependant de lasser, car le poète ne peut éviter la répétition et la redondance.
Or, par la
concentration des effets et la variété du ton, Victor Hugo réussit à esquiver l'écueil de la monotonie qui guette
toujours le genre satirique.
[1.
La concentration des effets]
En mobilisant une foule d'images, de métaphores et d'allusions fournies par sa vaste culture, de Cartouche à
Mandrin, de Sardanapale à Néron, de Judas à Shylock et à Robert Macaire, Victor Hugo réunit tous les criminels de
l'Histoire, du mythe et de la littérature pour donner à la figure abhorrée de Napoléon III le relief d'une caricature
inoubliable.
Ce portrait au vitriol doit constituer le châtiment par sa démesure même.
Parallèlement, tous les
libérateurs, de Moïse à Prométhée, de Josué au Christ, se rejoignent en un individu unique, le Poète.
Vengeur des
républicains, massacrés, exécutés, prisonniers ou proscrits, il appelle le peuple à se réveiller.
L'ennemi n'est plus
seulement le prince-président, mais la tyrannie de tous les temps ; les libérateurs ne sont plus une poignée
d'hommes résolus mais le Peuple tout entier, qui a dû se reconnaître dans les « va-nu-pieds superbes » de l'an II et
qui va continuer leur combat avec le même enthousiasme ; l'objectif de la France, fondatrice des droits de l'homme,
est dans l'immédiat le renversement du tyran, mais, à plus longue échéance, l'enjeu de sa lutte concerne l'humanité
tout entière, puisqu'il ne s'agit de rien de moins que de l'avènement du Progrès.
[2.
La variété du ton]
Mais là où Victor Hugo donne toute la mesure de son génie, c'est quand il intègre dans la satire les registres qui en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'oeuvre poétique de ARTHUR RIMBAUD
- L'oeuvre poétique de Leconte de Lisle
- Présentation de la vie et de l'oeuvre poétique de Gérard de NERVAL
- Analyse de l'oeuvre poétique d'Apollinaire
- Alors qu'il cherchait vainement un éditeur pour A la recherche du temps perdu, Proust écrivait en 1913, à la Nouvelle Revue française : Le point de vue métaphysique et moral prédomine partout dans l'oeuvre. Quelles réflexions vous inspire cette affirmation, si vous considérez plus particulièrement Du côté de chez Swann, qui parut à la fin de cette même année ?