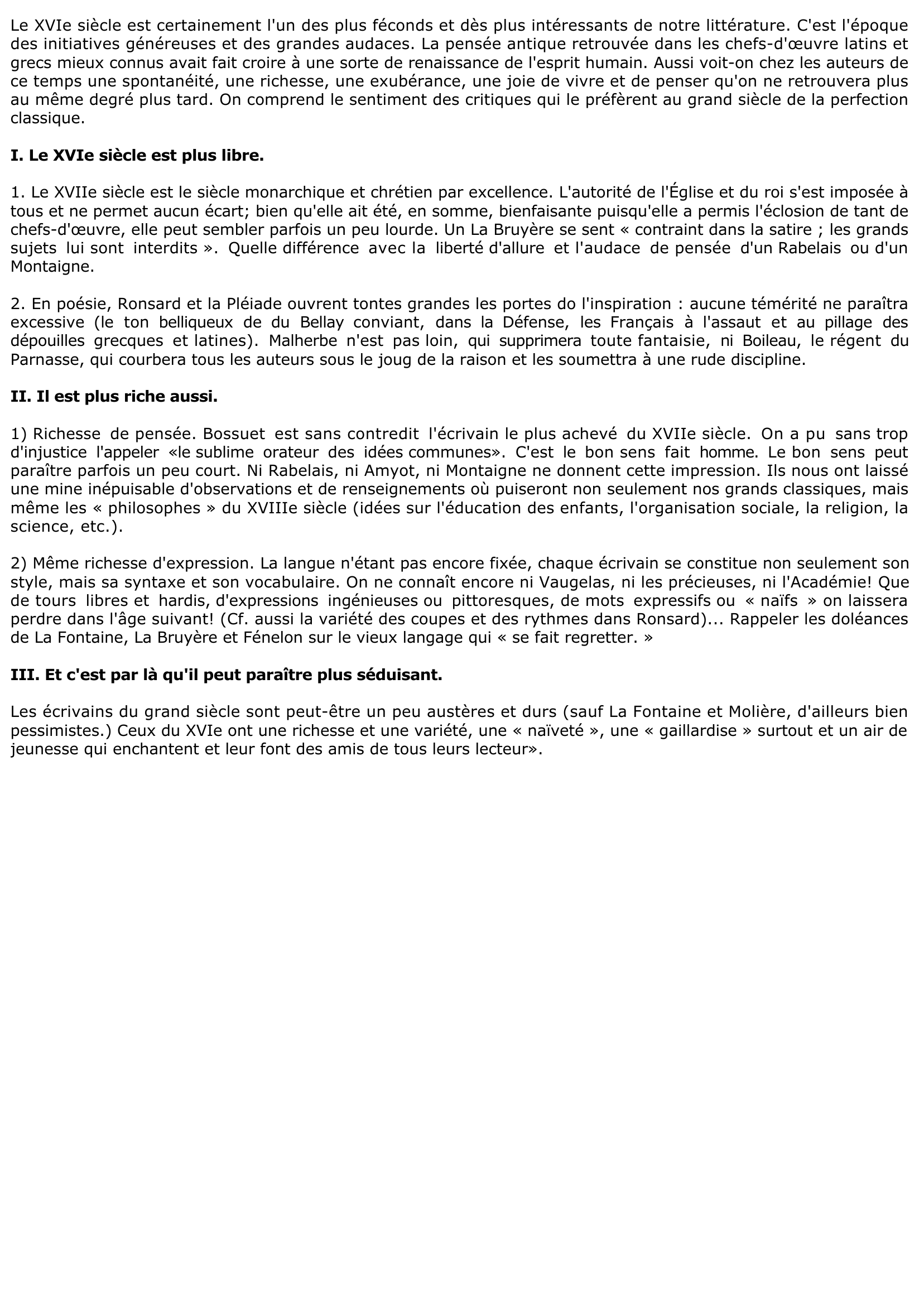Certains critiques préfèrent en littérature le 16e siècle au 17e; ils le trouvent plus riche, plus libre, plus séduisant. Dites votre avis ?
Extrait du document
«
Le XVIe siècle est certainement l'un des plus féconds et dès plus intéressants de notre littérature.
C'est l'époque
des initiatives généreuses et des grandes audaces.
La pensée antique retrouvée dans les chefs-d'œuvre latins et
grecs mieux connus avait fait croire à une sorte de renaissance de l'esprit humain.
Aussi voit-on chez les auteurs de
ce temps une spontanéité, une richesse, une exubérance, une joie de vivre et de penser qu'on ne retrouvera plus
au même degré plus tard.
On comprend le sentiment des critiques qui le préfèrent au grand siècle de la perfection
classique.
I.
Le XVIe siècle est plus libre.
1.
Le XVIIe siècle est le siècle monarchique et chrétien par excellence.
L'autorité de l'Église et du roi s'est imposée à
tous et ne permet aucun écart; bien qu'elle ait été, en somme, bienfaisante puisqu'elle a permis l'éclosion de tant de
chefs-d'œuvre, elle peut sembler parfois un peu lourde.
Un La Bruyère se sent « contraint dans la satire ; les grands
sujets lui sont interdits ».
Quelle différence avec la liberté d'allure et l'audace de pensée d'un Rabelais ou d'un
Montaigne.
2.
En poésie, Ronsard et la Pléiade ouvrent tontes grandes les portes do l'inspiration : aucune témérité ne paraîtra
excessive (le ton belliqueux de du Bellay conviant, dans la Défense, les Français à l'assaut et au pillage des
dépouilles grecques et latines).
Malherbe n'est pas loin, qui supprimera toute fantaisie, ni Boileau, le régent du
Parnasse, qui courbera tous les auteurs sous le joug de la raison et les soumettra à une rude discipline.
II.
Il est plus riche aussi.
1) Richesse de pensée.
Bossuet est sans contredit l'écrivain le plus achevé du XVIIe siècle.
On a pu sans trop
d'injustice l'appeler «le sublime orateur des idées communes».
C'est le bon sens fait homme.
Le bon sens peut
paraître parfois un peu court.
Ni Rabelais, ni Amyot, ni Montaigne ne donnent cette impression.
Ils nous ont laissé
une mine inépuisable d'observations et de renseignements où puiseront non seulement nos grands classiques, mais
même les « philosophes » du XVIIIe siècle (idées sur l'éducation des enfants, l'organisation sociale, la religion, la
science, etc.).
2) Même richesse d'expression.
La langue n'étant pas encore fixée, chaque écrivain se constitue non seulement son
style, mais sa syntaxe et son vocabulaire.
On ne connaît encore ni Vaugelas, ni les précieuses, ni l'Académie! Que
de tours libres et hardis, d'expressions ingénieuses ou pittoresques, de mots expressifs ou « naïfs » on laissera
perdre dans l'âge suivant! (Cf.
aussi la variété des coupes et des rythmes dans Ronsard)...
Rappeler les doléances
de La Fontaine, La Bruyère et Fénelon sur le vieux langage qui « se fait regretter.
»
III.
Et c'est par là qu'il peut paraître plus séduisant.
Les écrivains du grand siècle sont peut-être un peu austères et durs (sauf La Fontaine et Molière, d'ailleurs bien
pessimistes.) Ceux du XVIe ont une richesse et une variété, une « naïveté », une « gaillardise » surtout et un air de
jeunesse qui enchantent et leur font des amis de tous leurs lecteur»..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'écrivain contemporain, Claude Roy écrit dans Défense de le Littérature (1968): Certains esprits refusent le roman. Ils y voient une amusette, un gaspillage de force. Ils trouvent la vie (ou l'Histoire) plus riche en histoire, la science plus excitante et que la philosophie donne mieux a penser. Vous direz, en vous appuyant sur les textes du corpus, sur les romans que vous avez étudiez et sur vos lectures personnelles ce que vous pensez de ce jugement sur les romans rapporté par Clau
- « Nous autres, écrivains du XXe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire... Il n'y a pas pour l'artiste de bourreaux privilégiés... » A. Camus, Discours de Suède. La littérature a-t-elle attendu le XXe siècle pour lutter contre les bourreaux? Vous avez lu des textes qui prouven
- L'écrivain contemporain, Claude Roy écrit dans Défense de le Littérature (1968) : Certains esprits refusent le roman. Ils y voient une amusette, un gaspillage de force. Ils trouvent la vie (ou l'Histoire) plus riche en histoire, la science plus excitante et que la philosophie donne mieux à penser. Vous direz, en vous appuyant sur les textes du corpus, sur les romans que vous avez étudiez et sur vos lectures personnelles ce que vous pensez de ce jugement sur les romans rapporté par Cla
- « Nous autres, écrivains du xxe siècle, ne serons plus jamais seuls. Nous devons savoir au contraire que nous ne pouvons nous évader de la misère commune, et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire... Il n'y a pas pour l'artiste de bourreaux privilégiés... » A. CAMUS, Discours de Suède. La littérature a-t-elle attendu le XXe siècle pour lutter contre les bourreaux ? Vous avez lu des textes qui prouve
- Les données nouvelles de la littérature au XXe siècle