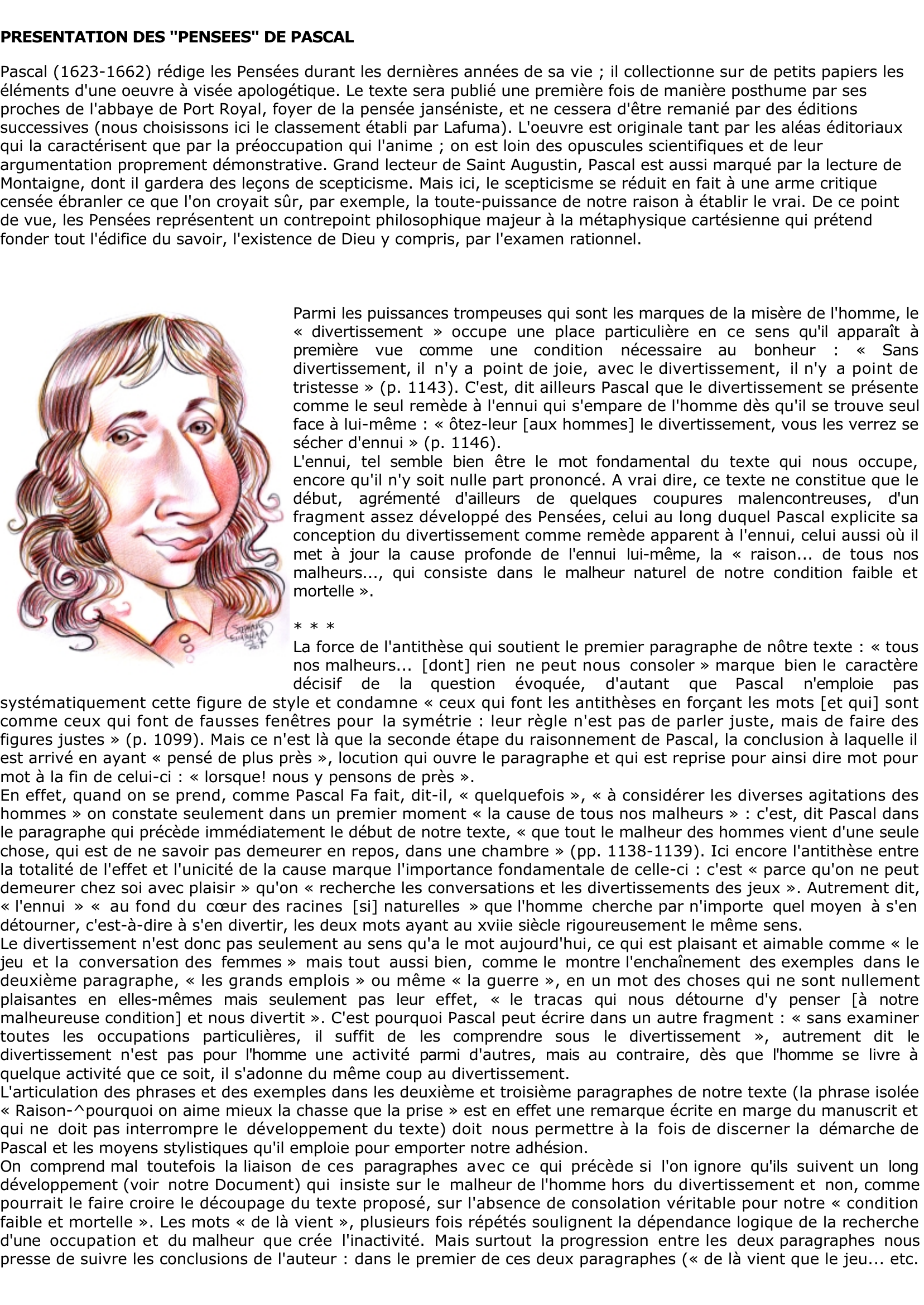Pascal : Pensées
Extrait du document
«
PRESENTATION DES "PENSEES" DE PASCAL
Pascal (1623-1662) rédige les Pensées durant les dernières années de sa vie ; il collectionne sur de petits papiers les
éléments d'une oeuvre à visée apologétique.
Le texte sera publié une première fois de manière posthume par ses
proches de l'abbaye de Port Royal, foyer de la pensée janséniste, et ne cessera d'être remanié par des éditions
successives (nous choisissons ici le classement établi par Lafuma).
L'oeuvre est originale tant par les aléas éditoriaux
qui la caractérisent que par la préoccupation qui l'anime ; on est loin des opuscules scientifiques et de leur
argumentation proprement démonstrative.
Grand lecteur de Saint Augustin, Pascal est aussi marqué par la lecture de
Montaigne, dont il gardera des leçons de scepticisme.
Mais ici, le scepticisme se réduit en fait à une arme critique
censée ébranler ce que l'on croyait sûr, par exemple, la toute-puissance de notre raison à établir le vrai.
De ce point
de vue, les Pensées représentent un contrepoint philosophique majeur à la métaphysique cartésienne qui prétend
fonder tout l'édifice du savoir, l'existence de Dieu y compris, par l'examen rationnel.
Parmi les puissances trompeuses qui sont les marques de la misère de l'homme, le
« divertissement » occupe une place particulière en ce sens qu'il apparaît à
première vue comme une condition nécessaire au bonheur : « Sans
divertissement, il n'y a point de joie, avec le divertissement, il n'y a point de
tristesse » (p.
1143).
C'est, dit ailleurs Pascal que le divertissement se présente
comme le seul remède à l'ennui qui s'empare de l'homme dès qu'il se trouve seul
face à lui-même : « ôtez-leur [aux hommes] le divertissement, vous les verrez se
sécher d'ennui » (p.
1146).
L'ennui, tel semble bien être le mot fondamental du texte qui nous occupe,
encore qu'il n'y soit nulle part prononcé.
A vrai dire, ce texte ne constitue que le
début, agrémenté d'ailleurs de quelques coupures malencontreuses, d'un
fragment assez développé des Pensées, celui au long duquel Pascal explicite sa
conception du divertissement comme remède apparent à l'ennui, celui aussi où il
met à jour la cause profonde de l'ennui lui-même, la « raison...
de tous nos
malheurs..., qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et
mortelle ».
* * *
La force de l'antithèse qui soutient le premier paragraphe de nôtre texte : « tous
nos malheurs...
[dont] rien ne peut nous consoler » marque bien le caractère
décisif de la question évoquée, d'autant que Pascal n'emploie pas
systématiquement cette figure de style et condamne « ceux qui font les antithèses en forçant les mots [et qui] sont
comme ceux qui font de fausses fenêtres pour la symétrie : leur règle n'est pas de parler juste, mais de faire des
figures justes » (p.
1099).
Mais ce n'est là que la seconde étape du raisonnement de Pascal, la conclusion à laquelle il
est arrivé en ayant « pensé de plus près », locution qui ouvre le paragraphe et qui est reprise pour ainsi dire mot pour
mot à la fin de celui-ci : « lorsque! nous y pensons de près ».
En effet, quand on se prend, comme Pascal Fa fait, dit-il, « quelquefois », « à considérer les diverses agitations des
hommes » on constate seulement dans un premier moment « la cause de tous nos malheurs » : c'est, dit Pascal dans
le paragraphe qui précède immédiatement le début de notre texte, « que tout le malheur des hommes vient d'une seule
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre » (pp.
1138-1139).
Ici encore l'antithèse entre
la totalité de l'effet et l'unicité de la cause marque l'importance fondamentale de celle-ci : c'est « parce qu'on ne peut
demeurer chez soi avec plaisir » qu'on « recherche les conversations et les divertissements des jeux ».
Autrement dit,
« l'ennui » « au fond du cœur des racines [si] naturelles » que l'homme cherche par n'importe quel moyen à s'en
détourner, c'est-à-dire à s'en divertir, les deux mots ayant au xviie siècle rigoureusement le même sens.
Le divertissement n'est donc pas seulement au sens qu'a le mot aujourd'hui, ce qui est plaisant et aimable comme « le
jeu et la conversation des femmes » mais tout aussi bien, comme le montre l'enchaînement des exemples dans le
deuxième paragraphe, « les grands emplois » ou même « la guerre », en un mot des choses qui ne sont nullement
plaisantes en elles-mêmes mais seulement pas leur effet, « le tracas qui nous détourne d'y penser [à notre
malheureuse condition] et nous divertit ».
C'est pourquoi Pascal peut écrire dans un autre fragment : « sans examiner
toutes les occupations particulières, il suffit de les comprendre sous le divertissement », autrement dit le
divertissement n'est pas pour l'homme une activité parmi d'autres, mais au contraire, dès que l'homme se livre à
quelque activité que ce soit, il s'adonne du même coup au divertissement.
L'articulation des phrases et des exemples dans les deuxième et troisième paragraphes de notre texte (la phrase isolée
« Raison-^pourquoi on aime mieux la chasse que la prise » est en effet une remarque écrite en marge du manuscrit et
qui ne doit pas interrompre le développement du texte) doit nous permettre à la fois de discerner la démarche de
Pascal et les moyens stylistiques qu'il emploie pour emporter notre adhésion.
On comprend mal toutefois la liaison de ces paragraphes avec ce qui précède si l'on ignore qu'ils suivent un long
développement (voir notre Document) qui insiste sur le malheur de l'homme hors du divertissement et non, comme
pourrait le faire croire le découpage du texte proposé, sur l'absence de consolation véritable pour notre « condition
faible et mortelle ».
Les mots « de là vient », plusieurs fois répétés soulignent la dépendance logique de la recherche
d'une occupation et du malheur que crée l'inactivité.
Mais surtout la progression entre les deux paragraphes nous
presse de suivre les conclusions de l'auteur : dans le premier de ces deux paragraphes (« de là vient que le jeu...
etc..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pascal, Les pensées, fragment 397 (extrait)
- Blaise Pascal (1623-1662), Pensées (1669), 139
- Fiche de lecture sur la lettre XXV des Lettre Philosophiques de Voltaire, critiquant les Pensées de Pascal.
- Pascal, Les Pensées, Pensée 142.
- Pascal a dit : « Ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du coeur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Mais ceux qui ne l'ont pas, nous ne pouvons la leur donner que par raisonnement en attendant que Dieu la leur donne par sentiment du coeur. » Vous montrerez comment Pascal a suivi ce dessein dans les Pensées.