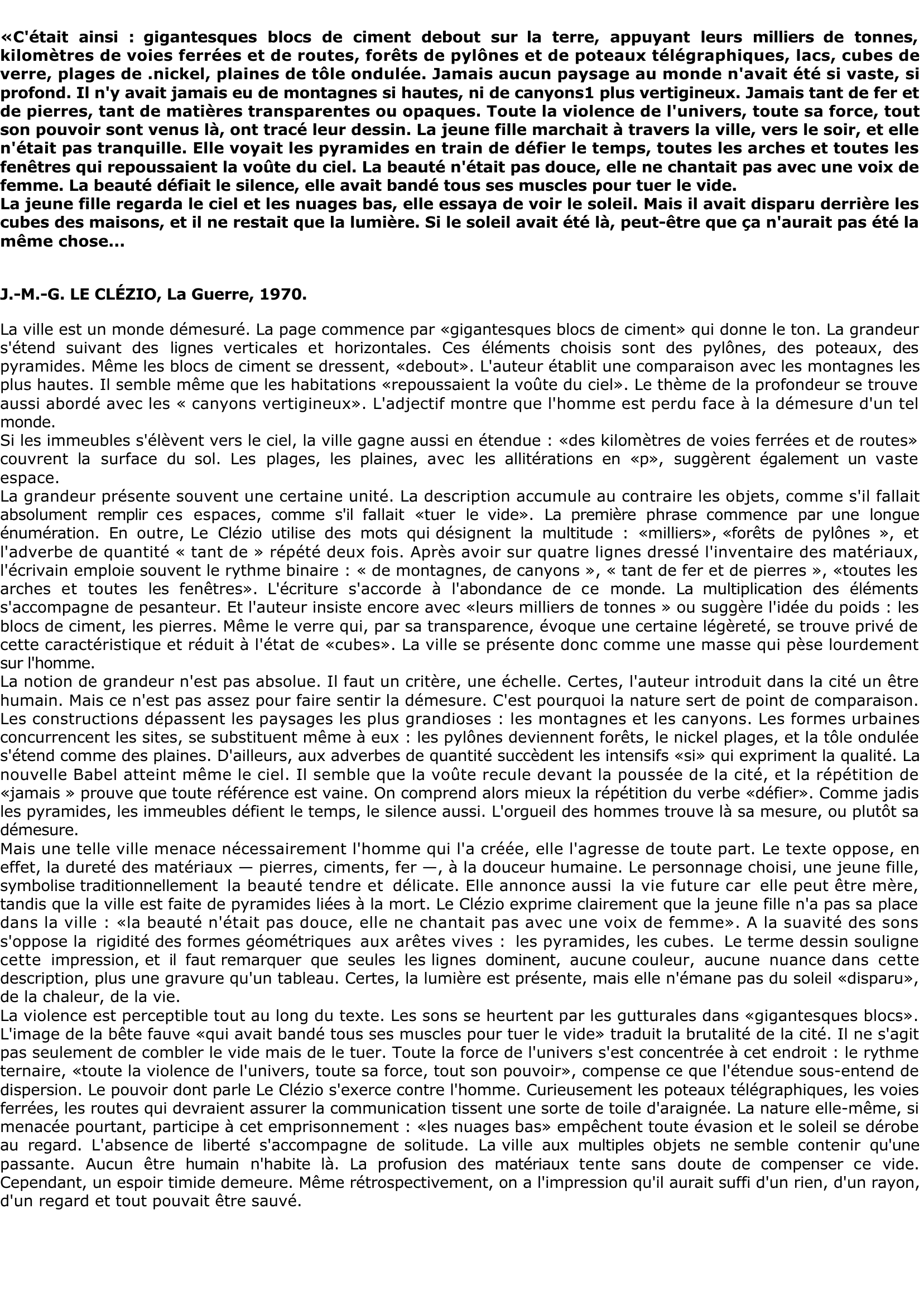LE CLÉZIO, La Guerre
Extrait du document
«
«C'était ainsi : gigantesques blocs de ciment debout sur la terre, appuyant leurs milliers de tonnes,
kilomètres de voies ferrées et de routes, forêts de pylônes et de poteaux télégraphiques, lacs, cubes de
verre, plages de .nickel, plaines de tôle ondulée.
Jamais aucun paysage au monde n'avait été si vaste, si
profond.
Il n'y avait jamais eu de montagnes si hautes, ni de canyons1 plus vertigineux.
Jamais tant de fer et
de pierres, tant de matières transparentes ou opaques.
Toute la violence de l'univers, toute sa force, tout
son pouvoir sont venus là, ont tracé leur dessin.
La jeune fille marchait à travers la ville, vers le soir, et elle
n'était pas tranquille.
Elle voyait les pyramides en train de défier le temps, toutes les arches et toutes les
fenêtres qui repoussaient la voûte du ciel.
La beauté n'était pas douce, elle ne chantait pas avec une voix de
femme.
La beauté défiait le silence, elle avait bandé tous ses muscles pour tuer le vide.
La jeune fille regarda le ciel et les nuages bas, elle essaya de voir le soleil.
Mais il avait disparu derrière les
cubes des maisons, et il ne restait que la lumière.
Si le soleil avait été là, peut-être que ça n'aurait pas été la
même chose...
J.-M.-G.
LE CLÉZIO, La Guerre, 1970.
La ville est un monde démesuré.
La page commence par «gigantesques blocs de ciment» qui donne le ton.
La grandeur
s'étend suivant des lignes verticales et horizontales.
Ces éléments choisis sont des pylônes, des poteaux, des
pyramides.
Même les blocs de ciment se dressent, «debout».
L'auteur établit une comparaison avec les montagnes les
plus hautes.
Il semble même que les habitations «repoussaient la voûte du ciel».
Le thème de la profondeur se trouve
aussi abordé avec les « canyons vertigineux».
L'adjectif montre que l'homme est perdu face à la démesure d'un tel
monde.
Si les immeubles s'élèvent vers le ciel, la ville gagne aussi en étendue : «des kilomètres de voies ferrées et de routes»
couvrent la surface du sol.
Les plages, les plaines, avec les allitérations en «p», suggèrent également un vaste
espace.
La grandeur présente souvent une certaine unité.
La description accumule au contraire les objets, comme s'il fallait
absolument remplir ces espaces, comme s'il fallait «tuer le vide».
La première phrase commence par une longue
énumération.
En outre, Le Clézio utilise des mots qui désignent la multitude : «milliers», «forêts de pylônes », et
l'adverbe de quantité « tant de » répété deux fois.
Après avoir sur quatre lignes dressé l'inventaire des matériaux,
l'écrivain emploie souvent le rythme binaire : « de montagnes, de canyons », « tant de fer et de pierres », «toutes les
arches et toutes les fenêtres».
L'écriture s'accorde à l'abondance de ce monde.
La multiplication des éléments
s'accompagne de pesanteur.
Et l'auteur insiste encore avec «leurs milliers de tonnes » ou suggère l'idée du poids : les
blocs de ciment, les pierres.
Même le verre qui, par sa transparence, évoque une certaine légèreté, se trouve privé de
cette caractéristique et réduit à l'état de «cubes».
La ville se présente donc comme une masse qui pèse lourdement
sur l'homme.
La notion de grandeur n'est pas absolue.
Il faut un critère, une échelle.
Certes, l'auteur introduit dans la cité un être
humain.
Mais ce n'est pas assez pour faire sentir la démesure.
C'est pourquoi la nature sert de point de comparaison.
Les constructions dépassent les paysages les plus grandioses : les montagnes et les canyons.
Les formes urbaines
concurrencent les sites, se substituent même à eux : les pylônes deviennent forêts, le nickel plages, et la tôle ondulée
s'étend comme des plaines.
D'ailleurs, aux adverbes de quantité succèdent les intensifs «si» qui expriment la qualité.
La
nouvelle Babel atteint même le ciel.
Il semble que la voûte recule devant la poussée de la cité, et la répétition de
«jamais » prouve que toute référence est vaine.
On comprend alors mieux la répétition du verbe «défier».
Comme jadis
les pyramides, les immeubles défient le temps, le silence aussi.
L'orgueil des hommes trouve là sa mesure, ou plutôt sa
démesure.
Mais une telle ville menace nécessairement l'homme qui l'a créée, elle l'agresse de toute part.
Le texte oppose, en
effet, la dureté des matériaux — pierres, ciments, fer —, à la douceur humaine.
Le personnage choisi, une jeune fille,
symbolise traditionnellement la beauté tendre et délicate.
Elle annonce aussi la vie future car elle peut être mère,
tandis que la ville est faite de pyramides liées à la mort.
Le Clézio exprime clairement que la jeune fille n'a pas sa place
dans la ville : «la beauté n'était pas douce, elle ne chantait pas avec une voix de femme».
A la suavité des sons
s'oppose la rigidité des formes géométriques aux arêtes vives : les pyramides, les cubes.
Le terme dessin souligne
cette impression, et il faut remarquer que seules les lignes dominent, aucune couleur, aucune nuance dans cette
description, plus une gravure qu'un tableau.
Certes, la lumière est présente, mais elle n'émane pas du soleil «disparu»,
de la chaleur, de la vie.
La violence est perceptible tout au long du texte.
Les sons se heurtent par les gutturales dans «gigantesques blocs».
L'image de la bête fauve «qui avait bandé tous ses muscles pour tuer le vide» traduit la brutalité de la cité.
Il ne s'agit
pas seulement de combler le vide mais de le tuer.
Toute la force de l'univers s'est concentrée à cet endroit : le rythme
ternaire, «toute la violence de l'univers, toute sa force, tout son pouvoir», compense ce que l'étendue sous-entend de
dispersion.
Le pouvoir dont parle Le Clézio s'exerce contre l'homme.
Curieusement les poteaux télégraphiques, les voies
ferrées, les routes qui devraient assurer la communication tissent une sorte de toile d'araignée.
La nature elle-même, si
menacée pourtant, participe à cet emprisonnement : «les nuages bas» empêchent toute évasion et le soleil se dérobe
au regard.
L'absence de liberté s'accompagne de solitude.
La ville aux multiples objets ne semble contenir qu'une
passante.
Aucun être humain n'habite là.
La profusion des matériaux tente sans doute de compenser ce vide.
Cependant, un espoir timide demeure.
Même rétrospectivement, on a l'impression qu'il aurait suffi d'un rien, d'un rayon,
d'un regard et tout pouvait être sauvé..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation "comment la guerre froide a-t-elle pris fin en Europe et dans le monde?"
- L'intellectuel Emmanuel Berl écrivait en 1972 (Le Virage):« L'homme a déclaré la guerre à la nature, il la cassera ou la perdra. »
- La Guerre de Troie n'aura pas lieu JEAN GIRAUDOUX (1882-1944)
- JEAN GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n'aura pas lieu, II, 5.
- Antoine de Saint-Exupéry: Pilote de guerre